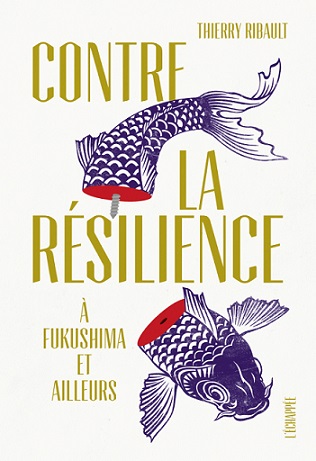
■ Thierry RIBAULT
CONTRE LA RÉSILIENCE
À Fukushima et ailleurs
L’Échappée, 2021, 368 p.
« Depuis 2011, c’est-à-dire trois générations après Hiroshima,
les Japonais sont redevenus des rats de laboratoire. »
Jean-Marc Royer, Le monde comme projet Manhattan.
« Ce qu’il y a de plus terrifiant dans la radioactivité, c’est qu’elle anéantit l’esprit, cela je le sens profondément en moi. Sur la moindre chose de la vie quotidienne, j’ai des doutes. Il n’y a plus aucune certitude. Tout vacille. Tout est faux. C’est ainsi que l’on étouffe les consciences », constate Yasuhiro Abe, responsable du Cinema Forum Fukushima, en cet automne 2012, soit un an et demi après que les cœurs de trois réacteurs de la centrale nucléaire Fukushima Daiichi sont entrés en fusion. Tout vacille, tout est faux, conscience à l’étouffe, ces quelques mots suffiraient presque à condenser le patient et minutieux travail de Thierry Ribault dans son dernier livre intitulé Contre la résilience. Au fil des pages, l’auteur y décortique les pans psychologiques, techniques et politiques de cette résilience, vue comme « technique du consentement ». Aux manettes de cette « cogestion de l’agonie » on trouvera sans surprise les différentes strates des pouvoirs publics nippons, mais aussi des sociétés savantes parmi lesquelles le FURE de Fukushima (FUkushima FUture Center for REgional REvitalization) dont l’ambition est de promouvoir une « cogestion post-catastrophique » par notamment la préconisation de « bonnes pratiques » visant à vivre en bon voisinage avec les radio-isotopes ou bien ces fameux « Dialogues » organisés par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) où de patentés experts invitent des résidents savamment déboussolés à domestiquer, sinon à fuir, tout sentiment de terreur et de désespoir face à la menace radioactive. De la résilience vue comme capacité d’un matériau à retrouver son état antérieur malgré des chocs répétés à celle d’humains invités à repeupler leur territoire souillé par l’empreinte du feu nucléaire, le défi est finalement aussi simple qu’un « rebond » nietzschéen insinuant que tout ce qui ne tue pas rend plus fort.
Vu de France, de cette notion de résilience, nous avons surtout en mémoire les travaux du très médiatique neuropsychiatre Boris Cyrulnik, auteur, entre autres, à la fin des années 1990 d’Un merveilleux malheur, oxymore censé nous inviter à nous inspirer de ces femmes et hommes ayant réussi à se réédifier après avoir enduré des épreuves et des souffrances qui en auraient terrassé plus d’un. De prime abord donc, rien de bien méchant dans ce qui peut apparaître comme une évidente ressource psychique adossée à toute pulsion de vie. On aurait là, disséminées en chacun de nous, les pousses d’une irréductible vitalité qui ne demanderaient qu’à être tutorées afin de nous permettre de faire des obstacles du quotidien autant de tremplins vers un accomplissement toujours plus abouti de sa petite personne. N’en demeure pas moins qu’au prisme de cette psychosociologie individualisante, le tri se fait déjà sentir entre ceux qui auront les ressources de se reconstruire et ceux qui ne les auront pas. Car si la résilience est avant tout un travail sur soi, intériorisation et métabolisation des afflictions, sa distribution parmi les vivants est terriblement inégalitaire. La résilience n’est pas cicatrisation naturelle et universelle, elle s’achemine et se mérite dans la douleur car comme le dit Ribault : « Seul celui qui sait souffrir peut prétendre à la survie. » De là à tisser les contours d’un « eugénisme doux », la tendance d’un énième avatar de type darwinisme social méritait d’être prise au sérieux, surtout quand ses ressorts les plus pervers sont mis en œuvre pour inviter des cohortes de citoyens hébétés à sanctuariser, nolens volens, cet écrin devenu hautement toxique du Tōhoku.
Qu’est donc cette « résilience » dont Thierry Ribault nous décrit les arcanes si ce n’est d’abord le déploiement d’une politique d’emprise totale s’attaquant au cœur et à l’esprit de ses cibles ? Le cœur que l’on va s’efforcer de drainer et d’assécher afin qu’il chasse tout mauvais sang lié à une peur rationnelle de l’irradiation ; l’esprit que l’on va retourner, tel un gant de cuisine, afin que la victime se ressaisisse de son destin pour devenir le bourreau sanitaire de sa survie quotidienne. Il faut visualiser ces scènes de la vie quotidienne : soit des mères conduisant à pied leur gosse à l’école, des mères munies de compteurs Geiger pour éviter les hot-spot (foyers à haute intensité radioactive) et protéger ainsi, comptine chantonnant, leur enfant des cocktails radionucléides. Car, après tout, les sapiteurs de l’atome ne l’ont-ils pas laissé entendre sur tous les tons : le danger n’est pas si grand. Et si danger il y a, il est d’abord dans la représentation que l’on s’en fait. Et c’est cette représentation, déraisonnablement anxiogène, que l’expertise nucléocrate se propose d’arc-en-cieliser. De la détresse au bien-être, la résilience est le chemin. À ceux qui ont fui leur maison, leur champ, leur bureau, leur jardin après la catastrophe nucléaire, le message se répète en boucle : dix ans après, il est grand temps de revenir. Décontaminés, balisés, échantillonnés et spectographiés, les lieux sont sûrs. Et si vous n’êtes pas convaincus c’est que subsiste au fond de vous un vieux frein nucléophobe, une peur fantasmatique qui n’a pas lieu d’être. Parole de scientifique. Parole bancale et meurtrière, nous dit Ribault, d’une science mobilisée « afin d’initier la population à l’attiédissement de son appréhension, et de lui fournir ainsi les meilleures raisons de s’adapter à la vie contaminée et de patiemment se sauver par elle-même ». Mieux : « de s’autodégrader en toute quiétude ». Parole bancale et meurtrière d’une science « non-faite » car fournissant des études lacunaires ou biaisées (ah ! ces fameux seuils d’exposition magiquement surévalués pour éviter aux autorités nippones d’avoir à évacuer des pans trop importants de population). Parole bancale et meurtrière d’une science vantant les bienfaits d’une délirante hormèse : soit l’ensemble des bénéfices attendus par un organisme boosté au césium-137 et autre strontium-90. Tous mutants, tous augmentés de tumeurs thyroïdiennes.
Le cauchemar est un rêve à l’envers ; irradié, le réel n’offre pas plus de prise qu’un « monde falsifié ». Ribault n’est pas un cynique et on le devine pétrifié par le dispositif qu’il met froidement à nu. Et s’il ne l’est pas, nous le sommes pour lui. Entre le nucléaire et les humains, l’attractive répulsion est vieille de plusieurs décennies et le mélange terreur/fascination est comme vitrifié. En pleine guerre froide, la galéjade diplomatique Atoms for Peace avait pour terreau le charnier des centaines de milliers de hibakusha de Hiroshima et Nagasaki. « La mort érotisée », diagnostiquait Jean-Marc Royer. La mort en maraude, partout et nulle part à la fois, silencieux comptes à rebours des sinueuses cancérogenèses. Contre ce destin de vie mutilée, contre cet enfumage institutionnalisé qui nécrose nos instincts de survie et altère nos facultés de jugement, Ribault met en garde : il y a un risque à tout attendre d’une « vérité rédemptrice ». Le risque de se vautrer dans les rets mathématisant d’une cogestion citoyenne, de se retrouver à son tour rouage parmi les rouages de l’ingénierie du désastre, de ne jamais se départir de son dosimètre pour vérifier en permanence son seuil d’exposition. Le risque de finalement consentir à une demi-vie emmaillotée de protocoles, fussent-ils produits par des instances indépendantes et à haute probité ajoutée. L’enjeu est ailleurs. Il s’agit de refuser l’accommodation pathogène vendue comme horizon indépassable par les thuriféraires d’une « culture pratique de la protection radiologique » ; il s’agit de « ressentir la menace, en devenir pleinement conscient, y compris par la peur, la fuir et s’attaquer à ses causes réelles ». Et Ribault de dégainer ce grand et vieux mot de « liberté », ringardisé aujourd’hui par les boutiquiers des sociologies postmodernes où l’humain ne serait qu’une bille de flipper valdinguée au rythme des bumpers de ses déterminismes. Or s’il est une chose essentielle à rechercher pour qui veut briser la gangue de son impuissance à agir, c’est bien ce « désir d’avoir le pouvoir nécessaire à la domination de ses conditions et choix de vie ». Au siècle dernier, une liberté sartrienne pensée sous la schlague de l’occupant – « où le venin nazi se glissait jusque dans notre pensée » – pouvait se comprendre comme « connaissance la plus profonde que l’homme peut avoir de lui-même » et « pouvoir de résistance aux supplices et à la mort » [1]. Contre cette reddition qui nous pousserait à nous machiner avec un complexe énergétique qui n’a jamais été rien d’autre que militaro-industriel, soit en guerre perpétuelle contre le vivant, il nous faut renouer avec et savoir accueillir cette archaïque et salutaire peur du danger qui, contrairement à ce qu’affirment en chœur les administrateurs de la catastrophe, est l’échelon premier de toute « prise de conscience de mener une existence dans un monde faux, c’est-à-dire un monde dans lequel le sujet est structurellement déplacé, et à ainsi opposer son refus d’être l’objet du remodelage artificiel visant son ajustement indéfini au nouvel environnement, un lifting antidouleur dont la résilience est le bistouri ».
Sébastien NAVARRO
