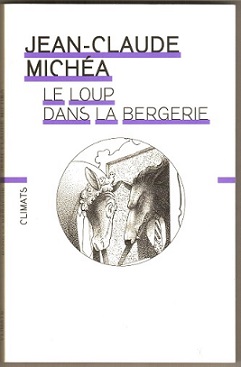
■ Jean-Claude MICHÉA
LE LOUP DANS LA BERGERIE
DROIT, LIBÉRALISME ET VIE COMMUNE
Paris, Climats/Flammarion, 2018, 168 p.
Colportée ad nauseam par l’anthropologie libérale, la formule attribuée à Hobbes selon laquelle l’homme serait un loup pour l’homme trouve ses origines, nous dit Jean-Claude Michéa, dans la Comédie des ânes de Plaute, mais sous un forme bien différente. « L’homme, écrivait en effet le poète latin, est un loup pour l’homme, et non un homme, tant qu’on ne le connaît pas », c’est-à-dire tant que, humainement reconnaissable, il nous demeure étranger. Avant d’être déshumanisé en somme par les marchands, que Plaute craignait bien plus que les loups.
Le texte qui sert d’ouverture à cet opus – une intervention prononcée à Nice, en novembre 2015, devant un parterre de juristes membres du Syndicat des avocats de France [1] – fut publié, en février 2016, sous le titre « Droit, libéralisme et vie commune », dans le numéro 48 de La Revue du Mauss. Repris ici « sans autres modifications que formelles et stylistiques » (p. 9), il s’organise autour de l’idée centrale que « c’est avant tout à travers l’idéologie des “droits de l’homme” – telle, du moins, que les “nouveaux philosophes” l’ont remise au goût du jour, à la fin des années 1970, sur fond de “néolibéralisme” triomphant – que le “loup de Wall Street” s’est introduit dans la “bergerie socialiste” » (p. 10). On remarquera, d’entrée et en passant, que ces « droits de l’homme » dont Michéa est présenté, dans les gazettes et sur les ondes du libéralisme culturel, comme le Grand Pourfendeur, sont une fois de plus précisement qualifiés, ce qui généralement échappe à ses détracteurs de gauche qui ont depuis longtemps choisi, sur le sujet, de puiser dans la boîte à outils de Foucault [2] plutôt qu’aux analyses toujours pertinentes de Marx, très présentes dans ce livre. Pour un lecteur familier des thématiques de Michéa, déclinées d’essai en essai avec une méritoire constance, ce texte vaut surtout pour ses qualités synthétiques. Et quelques formules-chocs dont il a le secret et qui, parfois, avec le temps, sonnent prophétiquement. Comme ce constat (de 2015) que nos experts en politologie journalistique, peu enclins il est vrai à lire La Revue du Mauss, avaient omis d’intégrer à leur logiciel, pour parler leur novlangue : « Qui commence par Kouchner finit toujours par Macron ! » (p. 41). À croire que, Michéa mis à part, seul notre Jupiter de l’ « itinérance » fut à même de comprendre qu’il incarnait désormais, pour ce néo-libéralisme cheminant sur ses deux jambes – marchande et culturelle –, l’archétype du right man in the right place. Et, en effet, le capital l’adouba dans le plus parfait enthousiasme en même temps que, le second tour venu, les antifascistes d’isoloir, les sociétaux de la gauche libérale, les émancipés des « archaïsmes sociaux » et les tout-acquis à l’illimitation des droits de l’individu atomisé.
Dans ce monde de la « séparation généralisée » (Debord), « le droit de tous sur tout, nous dit Michéa, a pour corrélat logique le droit de tous à se plaindre de tous » (p. 82). Ainsi s’organise, « par avocats interposés », une guerre sans fin de revendications sociétales, différencialistes, spiritualistes, identitaires ou communautaristes dont l’accumulation témoigne, pour le moins, d’une totale inversion de « l’idée de Marx selon laquelle on ne doit jamais juger les hommes sur la représentation qu’ils se font d’eux-mêmes mais d’abord sur ce qu’ils sont réellement » (pp. 33-34). À partir du moment, il est vrai, où tout ce qui faisait à peu près décence et sens communs s’est vu, dès la fin des années 1970, méthodiquement déconstruit par la pensée postmoderne – dont l’acte de naissance comme idéologie coïncide exactement avec la montée en puissance du néo-libéralisme –, le domaine infini de la lutte contre les « discriminations » et autres « stigmatisations » ne pouvait, logiquement, que conduire à une décomposition généralisée – et marchandisée – de tout lien social et, parallèlement à une extension illimitée du concept juridique du « nuire à autrui ». « Pour [les] libéraux historiques, rappelle Michéa, il allait de soi, par exemple, qu’il existait des critères suffisamment solides pour distinguer, dans la plupart des cas, un individu “sain d’esprit” d’un fou, un enfant d’un adulte, ou un homme d’une femme (p. 30). » Il semble que ces critères de simple bon sens aient si massivement rejoint la poubelle des « montages normatifs » et autres « constructions culturelles arbitraires » que « la pente naturelle du droit libéral (ou, si l’on préfère, la solution de facilité) sera donc, prévoit Michéa, de s’engager de plus en plus – au gré des différents rapports de forces (et de lobbying « associatif ») qui travaillent une société donnée – dans la voie d’une régularisation méthodique de tous les comportements possibles et imaginables (sur le mode sceptique, en somme, du “après tout, pourquoi pas ?”) [p. 34]. » Au risque, insiste-il, de dissoudre ce « minimum de langage commun et de normes culturelles communes », à défaut duquel, dans un monde si totalement déconstruit, le règne du « chacun-pour-soi » s’accorde à la guerre du tous contre tous, processus que décrivait déjà Engels, cité par Michéa, comme « la désagrégation de l’humanité en monades dont chacune à un principe de vie particulier et une fin particulière » (p. 35).
Concise, vivante et batailleuse, cette réflexion sur « Droit, libéralisme et vie commune » représente un petit tiers de ce Loup dans la bergerie que Michéa a enrichi, pour les deux autres, de trente-cinq « scolies » ou « remarques additionnelles de longueur inégale » dont le principal intérêt est de prolonger et, ici, d’actualiser son propos initial.
On connaît des lecteurs de Michéa déconcertés par sa méthode (sa « manie », écrit-il) qui procède toujours par ajouts, développements et commentaires. Pour les apprécier à leur juste valeur de pertinence et d’impertinence, il convient, comme le conseille l’auteur à chacun de ses ouvrages, de les lire après et non en même temps que le texte auquel ils se rapportent [3] – « comme autant de petits chapitres indépendants », précise-t-il. C’est, en effet, la meilleure manière de faire. Si le lecteur dispose d’un penchant pour la verve polémique, ce qu’on lui souhaite, il sera servi. Car, ici, l’auteur de L’Enseignement de l’ignorance s’y surpasse – avec, bien sûr, quelques excès ou approximations, mais le genre veut ça. Établir la liste des « flingués » de « tonton Michéa » serait, bien sûr, entreprise trop longue, d’autant qu’elle nécessiterait un exposé des motifs, qui eux-mêmes sont aussi variés que recevables. La dialectique michéenne ramasse, en tout cas, à la pelle les folies culturalistes d’époque pour les resituer dans ce « mouvement incessant du capital » – que Marx décrivait déjà, en son temps, comme étant par nature « sans limite » – et parvient aisément à démontrer en quoi et comment elles participent, par occultation, au « renforcement systématique (flexibilisation et précarisation du travail obligent) de l’exploitation de classe » (p. 145). Car le « langage des droits » a précisément pour fonction, de classe précisément, de dissimuler le constant processus de dégradation sociale qui travaille une société suffisamment déconstruite pour que toute résistance quelque peu conséquente à ses effets soit, désormais, passible, au nom du droit, d’être assimilée à du terrorisme.
On comprend, aisément, que, par ses saillies répétées, l’essayiste irrite – et un peu plus – la critique intellectuelle de gauche (les « libéraux-sociétaux ») qui, à juste titre, se sent visée par les charges qu’il réserve à sa post-moderne lecture du monde. De là à le transformer en idéologue « rouge-brun » ou en penseur « réactionnaire », il n’y a évidemment qu’un pas d’autant plus facile à franchir que la critique intellectuelle de droite, ravie de la volée de bois vert que ses adversaires en hégémonie libérale encaissent à chacun de ses brulôts, semble lui manifester, a contrario, une douteuse sympathie. Au-delà de cette droite, sur les rives du « populisme » identitaire le plus caverneux, font également florès les tentatives d’appropriation du philosophe. Quand Orwell et Debord se voient eux-mêmes annexés par la même racaille, il n’est pas étonnant que Michéa, qui s’en revendique, subisse pareil sort. Il faut être post-gauchiste ou post-anarchiste, ce qui aujourd’hui relève du même étiage de néant, pour n’avoir pas encore compris que, dans le dispositif spectaculaire de cette basse époque, est encouragé tout ce qui concourt au brouillage généralisé des repères d’évidence et que, pour ce faire, la récupération disqualifiante reste encore le meilleur moyen de semer la confusion, une confusion qui irrigue à un tel point le « débat d’idées » de ces temps dévastés que tout porte à croire que, réseaux aidant, on n’a jamais fait pire.
Le Loup dans la bergerie, où l’on côtoie des canidés et des ânes en pagaille, tient, en fait, du bestiaire en forme d’alerte. Il faut le prendre pour ce qu’il est, une nouvelle déclinaison de la thématique michéenne que lui-même résume ainsi : il y a « urgence politique absolue de renouer […] avec ce qui constituait autrefois le principe même des critiques socialistes, populistes et anarchistes. Autrement dit, avec l’idée, aujourd’hui plus actuelle que jamais, que l’ennemi le plus dangereux de la civilisation et de l’espèce humaine (et peut-être même, à terme, de toute vie terrestre), c’est d’abord la dynamique aveugle et insensée de l’accumulation sans fin du capital » (p. 159). Le message est clair : si aucun « mouvement populaire autonome », c’est-à-dire collectivement insoumis à toute « hégémonie idéologique et électorale » progressiste, ne se dresse, à partir de ses seuls intérêts et sur ses propres bases – l’autonomie de classe –, les carottes sont assurément cuites. La seule limite à l’expansion infinie du capital est là.
Apostille .– Cette recension aurait pu s’en tenir là si, par une de ces ruses dont elle a le secret, l’histoire, pour le coup réellement « disruptive », n’avait donné au livre de Michéa un prolongement pratique dont il convient de tirer quelques enseignements. On notera d’abord que ce mouvement dit des « gilets jaunes » attira immédiatement l’attention de l’auteur du Loup dans la bergerie qui, dès le 21 novembre 2018, lui manifesta sa sympathie dans une lettre ouverte où il donnait, à chaud, son sentiment sur sa signification. Ce texte, largement diffusé, se concluait ainsi : « La colère de ceux d’en bas (soutenus, je dois à nouveau le marteler, par 75 % de la population – et donc logiquement stigmatisé, à ce titre, par 95 % des chiens de garde médiatiques) ne retombera plus, tout simplement parce que ceux d’en bas n’en peuvent plus et ne veulent plus. Le peuple est donc définitivement en marche ! Et à moins d’en élire un autre […], il n’est pas près de rentrer dans le rang. Que les Versaillais de gauche et de droite (pour reprendre la formule des proscrits de la Commune réfugiés à Londres) se le tiennent pour dit ! » Peut-on voir, en gestation, dans ce mouvement, cette expression « populaire autonome » affranchie de toute « hégémonie idéologique et électorale » que Michéa appelle de ses vœux dans son livre ? Il est sans doute encore trop tôt pour le dire. Mais, plus d’un mois après son commencement, et alors que le calme n’est pas revenu, on peut accorder à ce mouvement – que Michéa rapproche, « [par] sa naissance, son programme rassembleur et son mode de développement, [à] la grande révolte du Midi de 1907 » (ibid.) – l’évident bénéfice d’avoir non seulement remis la question sociale – au sens le plus basique du terme – au centre du jeu politique, mais d’avoir manifesté une intelligence collective susceptible tout à la fois de néantiser le pouvoir des marquis et les grilles de lecture d’une gauche « radicale » radicalement dépassée par cet inquiétant réveil de la plèbe. On ne s’étonne pas que, dans son trou perdu « des Landes – à 10 kilomètres du premier commerce, du premier café et du premier médecin (26% des communes françaises, mondialisation oblige, sont déjà dans ce cas) » [4], Michéa ait perçu beaucoup plus vite que le 95% des experts attitrés, ce que cette levée en masse avait de généreux, mais aussi de fondateur. C’est ce qu’il explique dans cette seconde intervention : « C’est bien, en effet, ce peuple théoriquement “disparu” qui non seulement fait aujourd’hui son retour en force sur la scène de l’histoire, mais qui a même déjà obtenu – grâce à son sens politique exceptionnel et son inventivité rafraîchissante – plus de résultats concrets en quelques semaines que toutes les bureaucraties syndicales et d’extrême gauche en trente ans. Il fallait donc toute la cécité de classe des “écologistes” bourgeois pour ne pas avoir vu d’emblée que sous la question ponctuelle du prix de l’essence perçait déjà – pour reprendre les mots du remarquable Appel de Commercy – “un mouvement généralisé contre le système” et, au premier chef, contre cette confiscation croissante du pouvoir des citoyens par des politiciens de métier et des juges non élus. » Tout est là, à vrai dire, pour que, dans les consciences en mouvement, s’inventent, d’en bas, d’autres raisons de vivre, d’autres envies, d’autres désirs. Ce qui bouge est inédit, nettement, même si l’on peut y voir une réémergence de « cette pensée dialectique qui était celle, au XIXe siècle, de la majorité des critiques socialistes et anarchistes du nouveau monde capitaliste naissant » (Le Loup dans la bergerie, p. 136). Comme si le fil rouge de l’histoire ne cessait jamais souterrainement d’agir…
Manfredo GENZ
