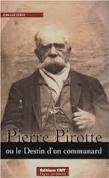
■ Jean-Luc DEBRY
PIERRE PIROTTE OU LE DESTIN D’UN COMMUNARD
Paris, Éditions CNT-RP, 2005, 214 p.
« Pirotte est un homme estimé qui gagne bien sa vie et qui, pour l’instant, ne se soucie pas de politique. » C’est par ces mots que s’ouvre – ou presque – le fort beau récit que Jean-Luc Debry consacre à Pierre Pirotte, son arrière-grand-père, et qui dépasse, et de beaucoup, le cadre de la saga familiale pour faire revivre, à travers le parcours d’un personnage attachant, une époque magnifique d’impertinence et de naïveté.
Tout commence le 4 septembre 1870. Les rues du Quartier latin, où réside le citoyen Pirotte, marchand de cannes de son état, résonne de ferveur populaire. Il assiste au spectacle, « attentif et assidu », mais dégagé de toute connivence politique particulière avec les manifestants. Place de l’Hôtel-de-Ville, la République est proclamée.
Une République fraternelle de paix et de justice, veut croire la foule en délire ; une République dès cet instant usurpée, pourtant, par les « Jules » (Favre, Ferry, Simon), qui rallient à leur cause le général Trochu – « participe passé du verbe trop choir », déclarera Victor Hugo – au nom des intérêts bien compris d’une bourgeoisie avant tout soucieuse de les préserver. Sitôt acclamée, donc, cette République, pourrie jusqu’au la moelle, entame sa marche vers la trahison du fol espoir qui la porta. L’Histoire est friande de ces journées de dupes où les fausses victoires dissimulent les vraies défaites. Ce 4 septembre 1870 fut, à l’évidence, de celle-là. Pirotte se contenta de la vivre au gré des événements, sans enthousiasme délirant, mais avec sympathie et « sa conscience pour lui ».
Il faut peu de temps pour que le républicain gouvernement « de Défense nationale » ne comprenne que, tout compte fait et pour Prussien qu’il soit, Bismarck offre à ses bourgeois représentants davantage de garantie que le peuple de Paris, dont l’ardeur patriotique est en train de s’armer de conscience de classe. Échappant de plus en plus à son contrôle, la Garde nationale, cette milice populaire née de la Grande Révolution et mise en sommeil sous l’Empire, se politise à grande vitesse. Elle formera les bataillons des futurs fédérés d’une Commune, dont l’idée germe déjà sous les rigueurs du Siège.
C’est précisément en rejoignant cette Garde nationale, comme instructeur, que Pirotte est happé, sans s’en douter encore, dans le tourbillon de l’Histoire. Ses raisons tiennent alors, pour l’essentiel, de la nécessité : il a 35 ans et, son commerce périclitant, il court, pour nourrir sa famille, après les 30 sous de solde qu’assure l’engagement. L’existence est ainsi faite : le besoin de survie précède la conscience d’une autre vie possible. C’est l’histoire d’un cheminement.
Celui de Pirotte le mène, étape par étape, de la conviction, vite acquise, que le peuple de Paris est seul à vouloir vaincre l’armée d’occupation à la certitude que cette fausse République doit être jetée aux poubelles de l’Histoire. Dépourvu de toute attache idéologique, c’est par l’expérimentation de la défaite et la perception de ses causes qu’il se détermine. « Trahis au Bourget, trahis à Buzenval, les gardes nationaux et les moblots comptaient leurs morts, écrit Debry. Morts pour rien ! On aurait voulu qu’ils apprissent à leurs dépens que la victoire n’était plus à l’ordre du jour qu’on ne s’y serait pas pris autrement. » En passant, comme tant d’autres combattants du Siège, du doute à la colère, le citoyen Pirotte s’ouvre progressivement aux échos de la révolte portés par l’ancienne mémoire de 1793 ou de 1848 et repris par les révolutionnaires de l’époque – blanquistes et membres de l’AIT, essentiellement –, unis sur l’objectif mais divisés sur la méthode. Dans les salles enfumées du café Campionnet ou de la brasserie Andler, que fréquente Pirotte, s’élaborent, au gré de l’événement, les contours d’une République sociale.
Il ne peut y avoir de révolution sans conjonction historique entre le rêve émancipateur porté par une minorité et la capacité d’agir du plus grand nombre. La révolution, c’est précisément ce moment où les exploités se saisissent de l’imaginaire révolutionnaire pour le rendre possible. La Commune fut, sans doute, une de ces brèches d’exception dans le mur de l’Histoire, un bonheur d’être au monde parce qu’on agit sur lui.
Le principal intérêt de ce livre – fort bien écrit au demeurant –, c’est précisément de marcher dans les pas du plus grand nombre – les communards de base–, dont les grandeurs et les faiblesses s’incarnent à merveille dans l’histoire de Pirotte, « homme d’ordre et de raison ». Car il ne faudrait pas croire que, sitôt mises en mouvement, les masses seraient forcément prêtes à monter à l’assaut du ciel. Elles hésitent autant qu’elles avancent. Il arrive même qu’effrayées de leur propre audace, elles stagnent ou reculent.
Il fallut du temps, par exemple, pour que les insurgés parisiens du printemps 1871 – ces hommes et ces femmes de base qui peuplent le récit de Debry – comprennent, quand ils l’ont compris, la vanité de leur légalisme républicain. Il fallut du temps, encore, pour que l’idée d’un compromis honorable avec les Versaillais disparaisse de leur esprit. Il fallut, en somme, que la volonté d’extermination des Thiers et des Gallifet tranche à leur place. Le capitaine Pirotte, qui fut de tous les combats et tint une des dernières barricades de la Commune, participa jusqu’à la Semaine sanglante de cette illusoire croyance que « la République devait pouvoir s’accommoder du programme de la Commune ». Il était loin d’être seul à le penser parmi ses frères de lutte.
Réussissant à échapper aux exécuteurs et aux mouchards, Pirotte parviendra par miracle, grâce à quelques complicités, à quitter Paris pour rejoindre son frère, installé dans l’Eure. Malgré les précautions d’usage, il sera dénoncé par les notables du lieu à la police, puis condamné, le 3 novembre 1871, à la déportation « simple » en Nouvelle-Calédonie. De Fort-Boyard à la forteresse de Quéhern, en passant par la citadelle de Saint-Martin-en-Ré, Pirotte connaîtra le triste sort des enfermés de la Commune, livrés aux caprices et aux brimades d’une soldatesque haineuse dans l’attente de leur transfert à Nouméa. Trois ans ainsi, avant le grand voyage vers cette Terra Incognita, où il débarque le 4 janvier 1875, après une longue et terrifiante traversée de cinq mois. On le destine à l’île des Pins, où il restera cinq ans, jusqu’à ce que fût promulguée, le 8 juillet 1880, l’amnistie pleine et entière des communards.
De ce temps de déportation, raconte Debry, Pierre Pirotte retiendra d’abord qu’il « fut un grand et bon moment de fraternité », cette fraternité qui naît des défaites et qui transcende l’épreuve. Ce livre, on l’aura compris, est un hommage à ce communard qui défia, par conscience, l’ordre du monde, mais aussi celui de sa propre vie. Un hommage mérité, un bel hommage.
Monica GRUSZKA
