■ Jean-Claude MICHEA
IMPASSE ADAM SMITH
Brèves remarques sur l’impossibilité de dépasser le capitalisme sur sa gauche
Castelnau-Le Lez, Climats, 2002, 186 p.
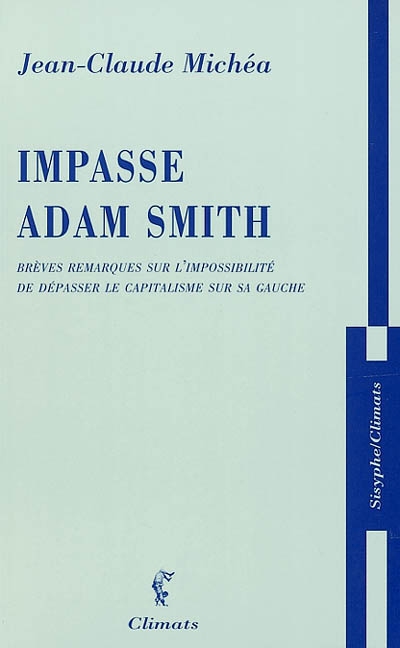
Jean-Claude Michéa écrit peu et, quand le besoin devient impérieux de prendre la plume, il ne le fait que parcimonieusement. D’où cette forme condensée d’écriture qui définit ses rares ouvrages : textes brefs où propositions et « scolies » – notes annoncées dans le texte par lettres alphabétiques et le prolongeant philosophiquement – s’enchevêtrent comme autant de figures d’une pensée dialectique. Chez lui, la méthode est invariablement spinoziste. Quant à la thématique – la critique radicale de la modernité et le dévoilement de cette « société de classe renforcée » qui l’accompagne –, Impasse Adam Smith en constitue, après Orwell, anarchiste tory et L’Enseignement de l’ignorance [1], un nouveau jalon.
À l’heure où un pitoyable débat agite « thermidoriens » et « nouveaux réactionnaires » à propos d’un livre remarquablement nul [2], Impasse Adam Smith fait l’effet d’un petit pavé dans cette mare du néant. Comme à son habitude, son auteur y aligne quelques figures notoires de l’élite moderniste et y étripe nombre de lieux communs abondamment médiatisés par ses porte-plume. À lire certains articles irrités mais « laudateurs » que son ouvrage a suscités, on jurerait qu’il s’y est amusé de leur insistance à le faire passer pour un auteur paradoxal et un tantinet provocateur. Quand le spectacle s’emploie à rattacher ses contempteurs aux dérisoires valeurs qui peuplent son univers – dont le goût du paradoxe et le sens de la provocation sont des figures de choix depuis que l’ « économie apologétique » se colore de Benetton – , il charge de la besogne ses journalistes et politologues appointés. Davantage que de récupérer, il s’agit pour eux de désamorcer le discours critique en intégrant ses impertinences supposées au dispositif spectaculaire. Au cœur de la réflexion de Michéa, pourtant, la ferme conviction d’une nécessaire rupture avec l’imaginaire progressiste de « la Gauche » et d’un retour aux sources d’un « socialisme ouvrier » anti-productiviste ne relève ni du paradoxe ni de la provocation, mais d’une claire et percutante analyse des conditions modernes de l’exploitation capitaliste.
Premier point : « Il n’existe, à mon sens, écrit Michéa, qu’une seule possibilité de développer de façon intégralement cohérente l’axiomatique ambiguë des Lumières : c’est l’individualisme libéral. Et la traduction politique la plus radicale et la plus logique de ce dernier se trouve dans le discours de l’Économie politique dont La Richesse des nations d’Adam Smith représente la version accomplie. » En liant la théorie du marché à la métaphysique du « libre échange généralisé [comme] meilleur fondement possible de l’harmonie sociale », ajoute Michéa, Adam Smith, dont le père était contrôleur des douanes, a transformé « l’hypothèse capitaliste » en une « théologie » qu’aucune mathématique n’a jamais confirmée et dont le « libéralisme radicalisé » d’aujourd’hui n’est que le stade mondialisé et, dit-on, l’indépassable horizon. Second point : « C’est l’existence de cette matrice originelle, commune à la pensée de la Gauche et au Libéralisme des Lumières, poursuit Michéa, qui explique, selon moi, les raisons qui ont toujours conduit la première à valider l’esprit du second sur l’essentiel, quand bien même il lui est assez souvent arrivé (et il lui arrivera encore) de souhaiter l’amender (ou le réguler) sur tel ou tel point particulier. » Au bout du compte, l’une et l’autre s’alimentent à la même « religion du Progrès » et du sens de l’Histoire, conclut-il, en y ajoutant ce corollaire qui tient de la remarque de bon sens : « Non seulement une certaine sensibilité conservatrice n’est pas incompatible avec l’esprit révolutionnaire, mais l’Histoire montre qu’elle en est généralement la condition. » Et comment le nier quand, des luddites et canuts aux travailleurs jetables d’aujourd’hui, l’histoire ouvrière est pleine d’actes de résistance s’inscrivant dans le refus du Grand Bond en avant capitaliste et de son éternelle aspiration à créer cet « homme nouveau » que les temps actuels semblent esquisser sous la défroque nomade et festive de l’esclave moderne.
Là où Michéa dérange assez le bel ordonnancement d’un monde intellectuel qui voue aux gémonies tout ce qui, de près ou de loin, est assimilable à l’archaïsme – modernité oblige ! –, c’est quand il s’entête à réactiver le double questionnement nietzschéen – qui parle et d’où ? – et à l’appliquer aux concepts tant vantés de métissage culturel et de nomadisme. Connaître la place qu’occupe, « personnellement », tel ou tel des actuels théoriciens ou publicitaires de l’ordre capitaliste planétairement réalisé est, après tout, une assez bonne méthode. Elle permet, en tout cas, de mesurer la légitimité de leurs discours – de classe – à « la lumière d’une déclaration de revenus ». Qu’on l’accuse de « populiste » – désormais « crime de pensée suprême » pour ceux qui contrôlent « l’industrie de la bonne conscience » –, Michéa n’en a cure, tant il sait – et prouve – que « l’une des manipulations les plus extraordinairement réussies durant ces vingt dernières années par les professionnels du mensonge journalistique, aura vraisemblablement été de transformer le concept de “populisme”, pièce maîtresse de l’héritage révolutionnaire depuis le XIXe siècle, en un concept-repoussoir à peu près synonyme de nazisme ». Passé maître dans « l’art d’effacer le passé », le journaliste moderne – que « le système a préposé à la défense médiatique de ses nuisances » – s’attelle à la tâche avec conscience. Sur ce point, le magistère de la vérité, qu’il détient et dont il abuse, n’est finalement pas très éloigné de l’orwellienne prédiction de 1984, novlangue comprise. Ayant fait du passé table rase, de la crise un bienfait, du nomadisme une vertu, de l’impertinence un devoir, de la fête une obligation et de Mai 68 une indépassable référence, le journaliste moderne – de « gauche » et « libéral-libertaire » de surcroît – se dépense à la tâche avec ferveur, scrutant ici ou là la « lepénisation des esprits » chez ces « gens ordinaires » que le capital condamne à la mort lente et à la « compassion philanthropique ». Se référer à ces « simples gens, ceux qui, par la force des choses, ont l’habitude de déchiffrer une société en la considérant sous le seul angle possible approprié, à savoir de bas en haut », aggrave le cas de Michéa. Ici ou là, on y a vu au mieux une posture, au pis un relent dangereux d’ouvriérisme mal digéré. Comme si, désormais, le seul fait d’adopter un point de vue que, naguère, on eût dit de classe suffisait, aujourd’hui, à déclencher persiflage ou rappel à l’ordre dans la presse que, jadis, on eût également dit de classe. C’était, il est vrai, au temps où Serge July et Edwy Plenel – « la pointe militante de cet ordre nouveau » – officiaient dans la marge d’un système dont ils sont dorénavant la norme. Au temps où le bourgeois avait encore figure balzacienne – ou chabrolienne. Au temps où le capital s’inventait un « nouvel esprit ».
« De nos jours, écrit précisément Michéa, la pire des illusions que puisse entretenir un militant de gauche, c’est de continuer à croire que ce système capitaliste, qu’il affirme combattre, constitue par essence un ordre conservateur, autoritaire et patriarcal, dont l’Église, l’Armée et la Famille définiraient les piliers fondamentaux. » Cette « illusion » – encore très amplement répandue, on l’admettra – repose sur une absolue confusion entre l’ « esprit bourgeois » et l’ « esprit du capitalisme ». Le premier, malgré quelques résistances, est en passe de disparaître. Le second, lui, réalise activement son programme : faire de chaque individu de la commercial society (comme disait Adam Smith) un « homme sans qualité », un esclave consentant et éternellement « flexible et mobilisable », une « particule élémentaire » du capital à son stade actuel d’accumulation. S’attacher aux anciennes figures de l’oppression, à cet « esprit bourgeois » que l’ « esprit du capitalisme » a lui-même terrassé, c’est effectivement se tromper d’époque. Pour le prouver, Michéa n’a pas tort d’accorder toute l’importance qu’elles méritent aux clairvoyantes analyses de Christopher Lasch [3], qu’il a d’ailleurs beaucoup contribué à introduire auprès du lectorat français. « L’un des plus grands mérites théoriques de Lasch, affirme Michéa, est assurément d’avoir toujours su prendre au sérieux [une] hypothèse de Marx » selon laquelle « le système capitaliste porte en lui – comme la nuée l’orage – le bouleversement perpétuel des conditions existantes. » Appliquée à la société de notre époque, l’hypothèse marxienne permet de comprendre pourquoi « tous les rapports sociaux stables et figés, avec leur cortège de conceptions et d’idées traditionnelles et vénérables, se dissolvent ». « La bourgeoisie, ajoutait Marx, ne peut exister sans révolutionner constamment les instruments de production et donc les rapports de production, c’est-à-dire l’ensemble des rapports sociaux. » Révolutionnaire, moderne et progressiste par nature, le capitalisme – cette « guerre de tous contre tous », disait Marx – ne s’encombre des anciennes vertus qu’il avait bâties (décence, travail, autorité, épargne et ordre moral) qu’à condition qu’elles servent encore sa « représentation économique du monde ». Quand elles l’entravent, il s’en débarrasse et lui en substitue d’autres. Ainsi, de cette « culture du narcissisme », surgie au cours des années 1960 et admirablement analysée par Lasch, le « capitalisme réellement existant » retiendra l’essentiel – son « hédonisme » de pacotille et son « individualisme » forcené – qu’il intégrera rapidement à sa sphère. À charge pour lui de transformer le vieux monde, en en confiant la tâche à cette « insolente jeunesse » des années 1970 qui, à sa place aujourd’hui dans le spectacle, assure sa promotion avec dévouement et efficacité. Jamais, sans doute, rébellion ne fut plus utile.
« La critique de l’aliénation progressiste doit devenir le premier présupposé de toute critique sociale », affirme Michéa, avant de préciser : « Et malheureusement c’est une critique qui, jusqu’à présent, n’a guère dépassé le stade des commencements. » Pour le faire, elle devra forcément rompre avec cette « gauche » que rien ne sépare de la « droite » puisqu’ « elle est devenue (…) une simple machine politique destinée à légitimer culturellement, au nom du “progrès” et de la “modernisation”, toutes les fuites en avant de la civilisation libérale ». Cette gauche-là, Michéa la fait remonter à l’affaire Dreyfus, événement qui lia les héritiers du socialisme au camp républicain. Nécessaire sans doute pour combattre l’antisémitisme, ce « compromis historique » projeta les premiers dans la modernité en les amputant, néanmoins, du rapport éminemment critique que ses prédécesseurs entretenaient avec elle. Or, c’est précisément de ce côté-là, indique Michéa, qu’il faut se tourner pour avoir quelque chance d’enrayer « la dynamique objective d’un système » qui, à travers ses instruments de contrôle médiatique et de légitimation, prive même ses vassaux de la capacité d’ « imaginer une figure de l’avenir qui soit autre chose que la simple amplification du présent ». Cette « décolonisation de l’imaginaire » passe par la réactivation de « tout ce qu’il y a eu d’excellent, ou tout simplement de raisonnable, depuis le XIXe siècle, dans les multiples critiques socialistes, anarchistes et populistes de la modernité ». Elle passe encore par « le souci de maintenir et d’universaliser cette common decency » qu’Orwell, invariable source d’inspiration pour Michéa, plaçait au centre de tout projet de construction d’ « une société d’individus libres et égaux, reposant autant qu’il est humainement possible sur le don, l’entraide et la civilité ».
On notera, pour finir et pour s’en étonner, qu’Impasse Adam Smith obtint peu d’échos dans la presse libertaire. On ajoutera qu’il en fut de même pour les précédents ouvrages de Michéa. À croire qu’ils dérangent là encore quelques illusions persistantes, convictions progressistes et réputations établies. On le déplorera, sans plus. Et à son usage exclusif, on lui dédiera ces quelques lignes de l’auteur, que nous faisons évidemment nôtres : « Pour éviter toute confusion, il convient naturellement de souligner les limites fondamentales de cette face “libertaire” du capitalisme (…) De même, en effet, que l’ “hédonisme” partout célébré dans le spectacle, n’est qu’un substitut pathétique de tout hédonisme réel, de même le triomphe présent de l’ “esprit libertaire” a peu de chose à voir avec ce qu’on entendait autrefois sous ce nom. Il suffit simplement, pour comprendre cet aspect des choses, de ne plus confondre les progrès de l’autonomie individuelle avec ceux de l’atomisation des individus, ni la libération effective des « mœurs » avec ce qui n’en a constitué jusqu’ici que la seule libéralisation ».
Freddy GOMEZ
