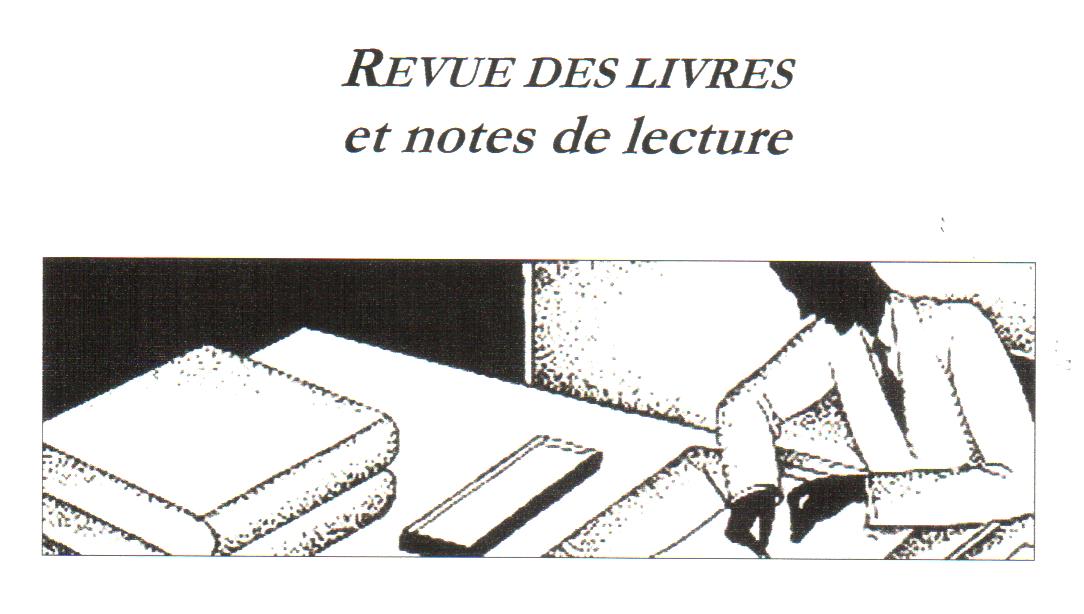■ Nico JASSIES
MARINUS VAN DER LUBBE ET L’INCENDIE DU REICHSTAG
Traduit du néerlandais par Quentin Chambon et Els van Daele
Paris, Éditions Antisociales, 2004, 192 p.
Marinus van der Lubbe, chômeur et militant révolutionnaire hollandais, incendia le Reichstag, le 27 février 1933, dans l’espoir d’éveiller un prolétariat allemand lobotomisé, à parts égales, par la social-démocratie et le stalinisme. Le geste fut vain, mais héroïque. Marinus le paya de sa vie après un procès-farce où nazis et kominterniens s’accusèrent mutuellement de manipulation, mais s’entendirent comme larrons en foire pour calomnier l’incendiaire, qui clama sa pleine et entière responsabilité de l’acte pour lequel on le jugeait. Décapité onze mois plus tard par les nazis, son geste devint, sous l’effet de la puissante machine à mentir stalinienne, synonyme de provocation. Jusqu’à nos jours, et bien au-delà des dictionnaires, comme on le verra.
En exergue de l’excellent ouvrage de Nico Jassies, on peut lire cette appréciation sur Van der Lubbe portée par Georges C. Glaser, l’auteur de Secret et violence - roman autobiographique, dont les éditions Agone annoncent une opportune réédition. Elle date de 1991 et précise : « Van der Lubbe était le type même du rebelle, qu’il fallait effacer de l’histoire, chasser de la conscience humaine. Voilà la leçon qu’ont tirée les nazis et les communistes de l’incendie du Reichstag. Van der Lubbe était pour eux un immense péril, précisément parce qu’il avait été en mesure de déconcerter ces deux pouvoirs mondiaux. Par l’initiative d’un seul homme. Le rebelle devait donc être remplacé par l’archétype de subalterne, du soldat de parti. »
Excellent, l’ouvrage de Nico Jassies l’est pour plusieurs raisons. Parce qu’il éclaire brillamment, en première partie, la personnalité et l’histoire de Van der Lubbe. Parce qu’il se livre, en deuxième partie (« Postface » et échange de correspondance avec Charles Reeve), à une critique - discutable par d’aucuns côtés, mais motivée pour l’essentiel - de certains points de vue défendus par Charles Reeve et Yves Pagès en complément des Carnets de route de l’incendiaire du Reichstag et autres écrits, édités par Verticales en 2003 [1]. Parce qu’enfin, il intègre, en troisième partie, une série de documents de grande valeur, dont des extraits de correspondance entre André Prudhommeaux, un des plus sûrs défenseurs de la mémoire de Van der Lubbe, et Helmut Rüdiger, Sidney E. Parker et le déjà cité Georges C. Glaser. Le tout, excellemment annoté, relève du travail d’orfèvre et prouve que N. Jassies est, sans aucun doute, l’un des meilleurs connaisseurs du sujet.
Reste que son livre a provoqué, dans le Landernau libertaire et d’ultra-gauche, une petite polémique dont il nous faut dire quelques mots... Outre des erreurs et approximations relevées dans l’édition des Carnets, N. Jassies reproche surtout à leurs commentateurs d’avoir défendu la mémoire de Van der Lubbe en instrumentalisant la vérité historique. Ainsi, rien ne justifierait, à ses yeux, qu’on rattachât son geste à un quelconque acte antifasciste quand ses seules motivations furent « anticapitalistes ». Sur ce point, on ne saurait lui donner tort, même s’il n’est pas certain que le geste lui-même ait fait, de la part de Marinus, l’objet d’un tel débat conceptuel. Ce qui est certain, en revanche, c’est que son auteur, communiste de conseil, fut calomnié au nom de l’antifascisme et parce qu’il en troublait le jeu. L’autre point, plus complexe, qui alimente le débat, a des prolongements dans l’histoire présente. Il tient au glissement opéré par C. Reeve et Y. Pagès, dans leur postface aux Carnets, des « conceptions complotistes » adoptées par les staliniens de 1933 à celles qui affleureraient, par exemple, dans le Debord dernière période qui dénonça le terrorisme des Brigades rouges comme étant manipulé par l’État italien. Sur ce point, N. Jassies a raison de s’en prendre au procédé d’amalgame et à la pratique du sous-entendu, même s’il se laisse lui-même aller à quelques légèretés, comme de prétendre que, d’ « avoir vécu les années 1960-1970 », Van der Lubbe aurait « sans doute... adhéré aux thèses et pratiques des situationnistes ». À trop vouloir prouver, on finit toujours par déraper. On finit aussi par oublier – ou oublier de dire, ce qui revient au même – que, pour lucides que fussent leurs thèses, en décembre 1969, au moment où éclatèrent les bombes de la piazza Fontana de Milan, les situationnistes, se rattachant à la sémantique en vigueur pour dénoncer une provocation mise en scène par un État, les titrèrent : « Le Reichstag brûle-t-il ? ». Comme quoi, quarante ans après , la falsification stalinienne des années 1930 avait porté ses fruits dans le langage commun, même chez les plus critiques.
Malgré cet oubli – et quelques dérapages verbaux propres à toute polémique –, ce livre est d’indispensable lecture, on l’aura compris.
Freddy GOMEZ
■ « NOSOTROS... »
IL Y A TRENTE ANS, SALVADOR PUIG ANTICH
Fragments du mouvement de l’histoire
SL, La Remembrance, 2005, 120 p.
Composé à la faveur d’une « sollicitation imprévue » – mais non explicitée –, ce court ouvrage restitue l’histoire de Salvador Puig Antich, garrotté en terre d’Espagne le 2 mars 1974. Il le fait avec émotion, mais sans lyrisme – et c’est tant mieux. Essentiellement construit à partir des témoignages des « sœurs Puig Antich », de Mariona, son amie des jeunes années, de Paco, son compagnon de lutte, le livre inclut le récit d’un prisonnier de la Modelo de Barcelone et des messages de sympathie envoyés à la famille de Salvador au lendemain de son exécution. Plus directement politiques, deux contributions rendent compte de l’histoire du MIL (Carles Sanz) et de la campagne de solidarité que la condamnation de Salvador déclencha de l’autre côté des Pyrénées (Jean Sera-Montès) Ces deux thématiques font également l’objet d’un texte d’ouverture, signé « Nosotros... » et intitulé « Brèves considérations sur l’histoire du mouvement ouvrier en Catalogne dans les années 60 », et d’un autre de conclusion, non signé celui-là – « La presse et la rue : réactions de l’opinion française à l’assassinat de Puig Antich ». Percent, ici, la nostalgie d’une époque où « en Espagne, une génération ne désespérait pas de changer le monde et la vie » et, là, quelques trous de mémoire, sur la douteuse attitude du secteur « orthodoxe » de la CNT en exil, notamment.
José FERGO
■ Frank FERNÁNDEZ
L’ANARCHISME À CUBA
suivi de Témoignages sur la révolution cubaine par Augustin Souchy
Préface de Lily Litvak - Illustration de couverture : Marcos Carrasquer
Paris, Éditions CNT-RP, 2004, 236 p.
En s’intéressant à une histoire largement ignorée, celle de l’anarchisme à Cuba, Frank Fernández, militant libertaire cubain et animateur assidu de la revue Guángara libertaria au cours des années 1980, fait indiscutablement œuvre utile et, au-delà, répare une injustice. Car c’est peu dire qu’aux heures chaudes du castrisme triomphant, les anarchistes cubains, premières victimes de la dictature tropicale, furent incompris par ceux-là mêmes qui, se réclamant du socialisme libertaire, auraient dû les soutenir dans l’adversité. On se souvient, par exemple, d’une pantalonnade organisée, en 1968, au Congrès anarchiste international de Carrare (Italie) par Daniel Cohn-Bendit et sa cour – les « radicaux » d’une époque qui ouvrit la voie aux plus fulgurantes reconversions –, vociférant « CIA ! CIA ! » pour couvrir l’intervention de Domingo Rojas, le représentant du Mouvement libertaire cubain en exil.
Inutile de dire que F. Fernández n’a pas oublié ce temps où le « fidélisme », cette variante du « caudillisme », porta les couleurs (vert kaki) de l’anti-impérialisme (yankee, bien sûr) sans qu’on s’interrogeât beaucoup, du côté de ses soutiens (libertaires compris), sur les dérangeantes réalités du « socialisme » de caserne instauré à Cuba. Le pire de tout, semble indiquer F. Fernández, c’est que, suivant le précepte orwellien qui veut que qui contrôle le présent contrôle le passé, le castrisme liquida progressivement non seulement les libertaires réellement existants sur l’île, mais parvint à effacer de la mémoire populaire toute trace de ce qu’ils avaient représenté. D’où l’intérêt de ce livre, qui se penche sur la longue histoire de l’anarchisme cubain et s’intéresse à ses principales figures, d’Enrique Roig San Martín à Marcelo Salinas.
Comme nous, on peut parier que le lecteur, même averti, apprendra beaucoup de la fréquentation de cet ouvrage, complété, dans une édition française particulièrement soignée, d’un remarquable témoignage sur la révolution cubaine, écrit à chaud (1960) par Augustin Souchy.
Freddy GOMEZ
■ Luciano LANZA
LA TÉNÉBREUSE AFFAIRE DE LA PIAZZA FONTANA
Traduit de l’italien, annoté et présenté par Miguel Chueca
Illustration de couverture : Marcos Carrasquer
Paris, Éditions CNT-RP, 2005, 228 p.
Il faut se féliciter que l’ouvrage de Luciano Lanza consacré à l’affaire de la piazza Fontana – paru en italien, en 1997, sous le titre Bombe e segreti – soit désormais disponible en langue française. D’autant qu’il l’est dans une excellente traduction et une édition soignée, rigoureusement annotée et augmentée d’une « chronologie essentielle » ainsi que d’une « lettre de Valpreda à la rédaction d’Umanità Nova, écrite depuis la prison de Regina Coeli, le 14 avril 1970 ».
« Evénement inaugural », écrit Miguel Chueca dans un avant-propos, le « massacre de la piazza Fontana » data « ce jour où, selon une expression maintenant consacrée, toute une génération politique perdit son innocence ». C’est donc de là qu’il faut partir « si on veut trouver son chemin dans l’obscurité des “années noires” de l’Italie et comprendre quelque chose aux faits qui ont ensanglanté son histoire entre 1970 et 1980 ».
Pour Luciano Lanza, l’attentat perpétré le 12 décembre 1969 contre la Banque de l’agriculture, située piazza Fontana, à Milan, marqua « un moment fondamental dans l’histoire de l’Italie de l’après-guerre ». Ce jour-là, ajoute-t-il en préface de La Ténébreuse Affaire de la piazza Fontana, « on vit se matérialiser la nature criminelle d’une classe politique qui, pour garder le pouvoir face à l’avancée du “communisme”, était prête à toutes les extrémités, y compris à semer sa route de cadavres afin que sa domination ne fût pas remise en cause. » Précédée par les explosions du 25 avril et 7 décembre de la même année et relayée, ce même 12 décembre 1969, par un autre attentat à Rome, la tuerie de Milan (16 morts et plus de 80 blessés) inaugura une « stratégie de la tension » de funestes conséquences puisqu’elle incita la gauche extra-parlementaire à « répondre, en élevant du coup le “niveau de la lutte” » à une droite qui avait « pris l’initiative de frapper la première ». Jeu pervers et logique absurde, poursuit L. Lanza, dont le principal effet fut de « [faire] entrer en crise presque tous les projets de changement radical de la société italienne », et ce jusqu’à nos jours.
C’est donc à cette « ténébreuse affaire » – juridico-policière –, mais surtout aux considérables enjeux politiques qu’elle recouvrit que L. Lanza consacre une passionnante enquête. « Je ne cache pas, précise-t-il, que j’ai vécu nombre de faits relatés ici en tant que militant anarchiste du Cercle du Ponte della Ghisolfa. Jusqu’au 15 décembre 1969, le jour de sa mort, j’ai partagé mon activité politique avec Giuseppe Pinelli et j’ai participé activement à la campagne pour la libération de Pietro Valpreda. Je suis donc impliqué, même sur le plan émotionnel, dans ces événements. Cependant, les trente-cinq années qui se sont écoulées depuis lors m’ont permis de me fixer pour but la plus grande objectivité possible. » Méticuleux dans son exposé et précis dans ses conclusions, L. Lanza, aujourd’hui journaliste et responsable de la revue Libertaria, remonte donc, pas à pas, le fil de cette sinistre opération. Avec, pour seule satisfaction, pourrait-on dire, la conviction, désormais étayée sur preuves, que, seuls contre tous, les anarchistes, principalement visés par le montage, avaient vu juste à l’époque en parlant de « massacre d’État ». Au grand dam de la presse qui en déduira une forte propension de leur part au délire et à la paranoïa. Et pourtant c’en fut bien un de massacre d’État, et dans les grandes largeurs, opéré par des mercenaires fascistes travaillant pour des services secrets, italiens et étrangers, et couverts par des flics, des juges et des ministres, c’est-à-dire toute une part de l’appareil d’État italien, un massacre sciemment organisé, inscrit dans une gradation et répondant à une stratégie : la préparation d’un coup d’État sur le modèle de celui des colonels grecs.
« Des fascistes mettent des bombes. La police arrête des anarchistes. C’est le schéma classique de cette affaire. Les directives viennent de haut : il faut frapper à gauche », écrit L. Lanza. Giuseppe Pinelli sera balancé du quatrième étage de la préfecture de Milan et Pietro Valpreda – « la bête humaine ! », titra la presse – tira, en toute innocence, trois ans de prison. Comme tout vient à qui sait attendre, la piste « nazi-fasciste » finit par intéresser quelques juges et journalistes, et ce d’autant que, sitôt assis sur les bancs de la justice, les suspects appartenant à ce bord-là étaient toujours innocentés. Ainsi, de fausse piste en fausse piste, le temps passa suffisamment pour que, recyclés les mercenaires du crime et revenus à de meilleurs procédés leurs commanditaires, la belle justice conclut tout bêtement, trente-six après l’attentat de la piazza Fontana, au non-lieu général. C’était le 3 mai de cette année, en cassation, à Milan.
« Les grands médias ont suivi l’évolution des procès d’un œil distrait, indique L. Lanza, et seuls les acquittements ont retenu un tant soit peu leur attention : la “raison d’Etat” voulait que personne ne fût jugé coupable... » Reste, ajoute-t-il en conclusion de sa remarquable enquête que, chaque 12 décembre, des manifestants se dirigent vers la piazza Fontana de Milan, bien décidés à refuser de s’incliner devant cette déraisonnable raison qui, après avoir fait endosser le crime à d’autres, a fini par ne l’imputer à personne, pour innocenter d’abord l’État coupable du massacre.
Freddy GOMEZ
■ Irene LOZANO
FEDERICA MONTSENY
Una anarquista en el poder
Madrid, Espasa Calpe, 2004, 432 p.
Les commémorations ont cela de bon – ou de mauvais – qu’elles offrent autant d’occasions d’aviver le souvenir. Ainsi, le centième anniversaire de la naissance de Federica Montseny, figure incontournable de l’anarchisme ibère, a donné lieu à quelques célébrations ou colloques et à la publication de deux ouvrages : l’un de Susana Tavera, que nous n’avons pas lu, et l’autre d’Irene Lozano, qui fait l’objet de cette recension.
Sa vie durant, F. Montseny s’est elle-même chargée, il est vrai, de construire son autoportrait en le désencombrant, de retouche en retouche, de ses aspérités, pesanteurs et incohérences. Au bout du compte, on peut dire que son principal talent fut de sentir le vent et de s’y adapter sans encombre. Antiféministe dans les années 1930, elle se découvrit sur le tard quelque affinité avec « Mujeres libres ». Collaborationniste en 1936, elle passa son exil à se défaire de ses habits de ministre – qu’elle endossa, rappelons-le, sans que personne ne la forçât. Cénétiste tardive – il fallut pour cela que la CNT se dotât d’un improbable Syndicat des professions libérales –, elle en fut, aux côtés de son mari, Germinal Esgleas, une représentante appointée, pendant les longues années d’exil. Tout cela, en cultivant son image de puriste de l’Anarchie et en livrant à l’anathème les hérétiques qui s’agitaient dans les rangs de plus en plus clairsemés de la CNT en exil.
Irene Lozano, sa biographe, avait donc fort à faire pour tracer un portrait véridique de l’héritière de la Revista blanca. À commencer par se déprendre de toute fascination journalistique pour un personnage qui, au premier abord, pouvait en susciter. Sur ce point d’importance, le but est atteint. Éloignée de toute cucuterie féministe et reposant sur un travail historique sérieux, la biographie d’Irene Lozano, faite de flash-back maîtrisés et portée par une écriture déliée, constitue une honnête approche du sujet, qui évite tous les pièges du genre, à l’exception, peut-être, d’une certaine propension à l’explication psychologique.
Il en ressort une peinture très nuancée de la Leona, surnom qu’elle reçut, dans les années 1930, quand elle porta le fer contre les « trentistes » au nom de la Très Sainte Anarchie. On y apprend, par exemple, que la jeune Montseny eut quelques difficultés à s’émanciper de sa famille de sang et d’idées – les Urales (Teresa Mañé et Juan Montseny, plus connu sous son pseudonyme de Federico Urales) –, qu’elle n’y parvint jamais complètement et que, refusant de vivre à l’ombre du père – un pape de l’Anarchie – ou désirant rivaliser avec lui, elle régla le problème en le déplaçant de la Revista blanca, revue qu’il avait fondée, pour y occuper sa place. L’amateur de passions familiales prendra, sur ce point, connaissance avec intérêt d’une lettre d’une extrême sévérité écrite, en 1937, par Federico à la « compañera Federica Montseny », alors ministre, où apparaissent comme catalogués les deux défauts que lui reprocheront ses adversaires : goût du pouvoir et fatuité.
On aurait tort de croire, cependant, qu’Irene Lozano instruit à charge. Son livre parvient même, au contraire, à révéler une Federica inconnue, mal dans sa peau, complexée, en butte au machisme d’une Espagne qui n’en était pas avare ; une Federica dont la passion secrète (et l’ambition frustrée) fut l’écriture littéraire ; une Federica insécure, fragile, à la féminité compliquée, transcendant ses doutes existentiels par une suractivité politique où abondent les figures d’autorité : l’oratrice, la ministre et l’inamovible dirigeante. Tamisant les lumières et éclairant les ombres d’une existence qui se confondit, pour partie, avec celle de la CNT, Irene Lozano trouve le ton juste pour en dire les tours et les détours.
Le pari était risqué. Pour l’essentiel, il est tenu.
José FERGO
■ Jacob LAW
DIX-HUIT ANS DE BAGNE
Marseille, Egrégores Éditions, 2005, 112 p.
Premier titre des éditions Egrégores, ces carnets de bagne de Jacob Law ont, indépendamment de leur incontestable valeur de témoignage, l’immense avantage de tirer son auteur du total oubli où il avait sombré.
Inconnu de tous les dictionnaires et éphémérides, Jacob Law (drôle de nom pour un hors-la-loi) purgea dix-huit ans du bagne de la pire espèce pour avoir tiré sur des policiers, place de la République, le 1er mai 1907, année restée célèbre par la vigueur de la répression anti-ouvrière. Ce 1er mai, pourtant, la maréchaussée de « Clemenceau briseur de grèves » visée par l’anarchiste individualiste Law ne déplora aucune victime.
Le voilà donc en Guyane, soudainement plongé dans le pire enfer et bien décidé à ne rien céder à « ce monstre qu’on appelle Administration » et qui s’entend si bien à octroyer « faveurs et places » à qui lui lèche la main et « corvées » à qui s’y refuse. Law est fait de ce bois qui ne plie pas. Le personnage tient de l’énergumène et du stoïque, du révolté définitif et du résistant. Contre les « porte-clefs », les « débrouillards », les « forts-à-bras », la « masse » – ces hommes, écrit-il, dont « le total égale un zéro » –, il oppose sa seule logique faite de refus multiples et d’insoumission revendiquée.
Étrange personnage, vraiment, que ce Law. Son témoignage ne s’encombre pas de sentiments. C’est une arme. Il fut publié, en 1926, aux éditions libertaires de L’Insurgé. Peu après, il sera expulsé du territoire français. Puis rien. Les seuls éléments qu’on ait donc sur sa biographie s’arrêtent là, à ceux qu’ils nous donnent dans ces Dix-huit ans de bagne. Juif, il naquit à Balta, en Transnistrie, fuit les pogroms lorsqu’il était enfant, vécut à Odessa, émigra à New York, Liverpool et Paris. Jeune, il lut le poète anarchiste yiddishophone David Edelstat – « celui qui m’a mis dans le droit chemin », écrit-il – et en retint une leçon de vie : s’opposer à l’oppression, d’où qu’elle vînt. C’est tout ce qu’on sait sur ce Jacob Law (plus probablement Léon, Lev, Liev, Lew ou Lévi, selon les transcriptions). C’est tout et c’est bien assez pour le lire.
Monica GRUSZKA
■ Jean-Manuel TRAIMOND
GUIDE ÉROTIQUE DU LOUVRE ET DU MUSÉE D’ORSAY
Photographies d’Ernesto Timor - Illustrations d’Aladdin
Lyon, Atelier de création libertaire, 2005, 144 p.
Jean-Manuel Traimond est guide de son métier. Autrement dit, il se cogne des touristes à longueur de journée, ce qui, soit dit entre nous, suppose une excellente santé. De la santé, il en a, Traimond, et à revendre, car il en faut pour peaufiner, entre deux visites, un vade-mecum érotique tel que celui qu’il nous offre. Qu’il nous offre, j’insiste, car ce livre tient bien du cadeau. Il est beau, agréable à lire, léger, élégamment illustré, juste ce qu’il faut polisson et cultivé à souhait. Exemple de coquinerie, au hasard. Entrée « masturbation », on lit : « La masturbation n’est pas représentée au Louvre. Du moins si l’on décide que, salle 41, aile Sully, les trois mâles d’un vase grec se contentent d’empêcher leur membre, dressé à angle droit, de tomber. » On lit encore, à propos cette fois de la Nymphe au scorpion, de Bartolini, que l’administration du Louvre, dans sa grande sagesse et de peur que le marbre ne s’use, a décidé de repousser la demoiselle « plus près de la fenêtre » pour éviter les caresses furtives à son verso de visiteurs attendris par sa « mollesse ». Ici, Traimond pointe (osons, osons...) un Enfant Jésus (celui de Giulio Pippi) au petit pénis bandant. Là, il s’ébaudit sur « les seins les plus pointus du Louvre », ceux d’Eos, peints par Pierre-Narcisse Guérin. Ailleurs...
On pourrait continuer longtemps tant le sujet est inépuisable, mais il y manquerait l’essentiel : le ton Traimond. Impayable. « Si l’indécence du fond n’a jamais été cause de censure, écrit-il, le langage de ce guide s’est gardé de tout écart quant à la forme. » On dirait du Brassens faisant visiter le Louvre à son copain Corne d’Auroch.
Marcel LEGLOU
■ José Luis GUTIERREZ MOLINA
LA TIZA, LA TINTA Y LA PALABRA
José Sánchez Rosa, maestro y anarquista andaluz (1864-1936)
SL, Ed. Tréveris-Libre Pensamiento, 2005, 386 p.
L’historien José Luis Gutiérrez Molina, dont nous avions déjà recensé favorablement un précédent ouvrage consacré à l’importante figure de Valeriano Orobón Fernández, réitère dans le genre biographique en tirant aujourd’hui de l’oubli celle de José Sánchez Rosa (1864-1936). Le résultat, une fois encore, se révèle concluant.
Cette biographie trace un portrait avantageux de Sánchez Rosa en le situant dans son temps : un long demi-siècle d’histoire sociale andalouse. Né la même année que l’AIT et mort, exécuté par les fascistes, aux premiers jours de la révolution espagnole de 1936, Sánchez Rosa, natif de Grazalema, dans la province de Cadix, prôna, sa vie durant, un anarchisme non violent. Sa « propagande par le fait » tenait de l’exemplarité individuelle : l’être anarchiste comme modèle et l’instruction rationaliste comme méthode. Autodidacte, il devint instituteur selon les règles établies par Francisco Ferrer, fut un propagandiste infatigable, par la parole et par l’écrit, de l’anarchisme stricto sensu et connut les prisons de la monarchie et celles de la République. Ses rapports avec la CNT des années 1920 et 1930, souvent conflictuels, fluctuèrent au gré des circonstances. Comme la famille Urales (Teresa Mañé, Juan Montseny et leur fille, Federica), dont il fut très proche, et qui, comme lui, s’imagina longtemps représenter le pur esprit de l’Anarchie contre la force brute de la lutte de classe incarnée par le syndicalisme révolutionnaire, il se défia avec constance d’un anarcho-syndicalisme de masse rêvant la synthèse entre l’Action et l’Idée et pratiquant avec constance la guerre sociale.
« Homme de son temps, écrit son biographe, il manifesta une confiance absolue envers le progrès et la capacité des hommes à fuir le mal. » Pour lui, il suffisait de croire, en somme, au mouvement ascendant de l’humanité et d’apporter la lumière au peuple. C’est à quoi il se consacra principalement, comme le prouve la publication, en seconde partie d’ouvrage, de plusieurs de ses courtes brochures de divulgation anarchiste. Éditées par sa propre maison d’édition – Biblioteca del obrero – et massivement diffusées, celles-ci utilisaient souvent la forme dialoguée, plus proche de la culture orale des paysans, pour dénoncer l’immoralité sociale et vanter l’Arcadie libertaire. Parallèlement à cette littérature didactique d’éveil social, Sánchez Rosa, fidèle à sa mission d’éducateur, édita également des ouvrages d’apprentissage : La aritmética del obrero, La gramática del obrero, El abogado del obrero, etc.
Complétée d’une chronologie minutieuse, d’un catalogue exhaustif de ses écrits et d’une bibliographie précieuse, cette biographie de l’anarchiste andalou Sánchez Rosa mérite réellement qu’on s’y attarde.
José FERGO
■ David RAPPE
LA BOURSE DU TRAVAIL DE LYON
Une structure ouvrière entre services sociaux et révolution sociale
Préface de Daniel Colson
Lyon, Atelier de création libertaire, 2004, 226 p.
David Rappe a raison de s’étonner, en ouverture d’ouvrage, que l’apport des Bourses du travail au syndicalisme français d’avant 1914, cette part essentielle de son originalité et de sa « spécificité », soit encore si peu étudié. Et de préciser : « Si l’on connaît globalement l’histoire des Bourses du travail [...], on connaît peu par contre les dynamiques et les objectifs internes que celles-ci s’étaient attribués, ainsi que le rôle qu’elles jouaient dans le quotidien des travailleurs de chaque localité [...]. » Le travail qu’il nous livre ici a donc le mérite, et ce n’est pas rien, de combler cette lacune pour ce qui concerne la Bourse du travail de Lyon .
Bien sûr, c’est la loi du genre universitaire, son étude, tirée d’un mémoire de maîtrise sur la Bourse de Lyon des origines à 1914 et d’un mémoire de DEA sur celles de la Loire, du Rhône, de l’Isère et de la Drôme des origines à 1939, pêche, sans doute, par trop de cette sécheresse si caractéristique des approches académiques. Mais, même si l’on eût aimé que surgisse, sous le poids des mots de l’historien, quelque chose du rêve émancipateur qui présida à cette riche expérience d’autonomie ouvrière, cette étude mérite qu’on s’y arrête, ne serait-ce que pour apprendre de ce temps, et éventuellement s’en inspirer.
Cette question du lien, D. Rappe, qui se réclame lui-même du syndicalisme révolutionnaire et milite dans cette sphère, se la pose avec d’autant plus d’acuité que sa démarche transcende le simple intérêt historique pour un objet de musée. Ainsi, écrit-il, « différentes expériences militantes, souvent à caractère autogestionnaire et libertaire comme les centres sociaux italiens ou certains espaces de vie et de lutte collectives » semblent, aujourd’hui, « faire le lien » avec cette histoire. Même si, prend-il soin de préciser, aucune d’elles « n’est encore allée aussi loin que l’expérience des Bourses du travail ni n’en a revêtu le même caractère de masse ».
Pour Daniel Colson, qui préface cet ouvrage, les Bourses du travail symbolisèrent à merveille l’ancienne revendication proudhonienne du nécessaire « séparatisme » de la classe ouvrière. « Si elle se prend au sérieux, assura l’auteur de De la capacité politique des classes ouvrières, si elle poursuit autre chose qu’une fantaisie [...], il faut qu’elle sorte de tutelle, et [...] qu’elle agisse désormais et exclusivement par elle-même et pour elle-même. » Tout à la fois contre-société et projet social d’autonomie, les Bourses du travail gèrent, en même temps et dans un même mouvement, le quotidien des travailleurs (placement, formation, santé, éducation, culture) en préparant l’avenir, le seul qui en finira avec les mauvais jours et dont la condition repose sur l’abolition du salariat par l’association libre des producteurs libres.
En étudiant la vie quotidienne de la Bourse du travail de Lyon, du début des années 1890 à la guerre de 1914, à travers son mode de fonctionnement, ses réalisations et ses conflits, D. Rappe touche une vérité essentielle : là se construisit un « autre socialisme », basé sur une « action syndicale autonome [...] porteuse de pratiques, d’une tactique, d’une stratégie et d’une finalité » et partant de ses propres profondeurs.
Cette expérience, le futur poids du marxisme sur le mouvement ouvrier fera tout pour l’occulter. Au nom de ses intérêts bien compris par son élite autoproclamée. Preuve s’il en est que les professionnels du socialisme, hier comme aujourd’hui, ont tout à craindre de la classe ouvrière quand, « par elle-même et pour elle-même », elle construit sa propre émancipation. Le livre de D. Rappe est, sur ce point, tout à fait probant.
Gilles FORTIN
■ Cornelius CASTORIADIS
UNE SOCIÉTÉ À LA DÉRIVE
Entretiens et débats 1974-1997
Paris, Seuil, 2005, 318 p.
« Ce volume, peut-on lire en présentation d’ouvrage, rassemble des entretiens et des débats auxquels participa entre 1974 et 1997 Cornelius Castoriadis – penseur protéiforme qui fut avec une égale passion militant politique, économiste, psychanalyste et philosophe. Ils correspondent à la deuxième partie de sa carrière, essentiellement consacrée à la réflexion philosophique après l’expérience de la revue et du groupe Socialisme ou Barbarie (1948-1967). » En réunissant ces entretiens, précisent les maîtres d’œuvre de cette sélection et éditeurs, par ailleurs, des séminaires tenus par Castoriadis à l’École des hautes études en sciences sociales, Enrique Escobar, Myrto Gondicas et Pascal Vernay osent espérer que leur lecture pourra « donner à certains l’envie d’aller (ou de revenir) à des textes où les positions de l’auteur sont présentées de façon plus étendue ». Nous le souhaitons avec eux.
Structuré en deux parties – « Itinéraire » et « Interventions » – et complété d’une très précieuse « Chronologie et bio-bibliographie », l’ouvrage rassemble une bonne vingtaine d’entretiens et de conférences abordant des thématiques souvent déterminées par l’actualité du moment – l’expérience d’Union de la gauche en France, l’effondrement du bloc de l’Est, la guerre du Golfe, entre autres – et la prolongeant.
Sur l’itinéraire de Castoriadis depuis son arrivée en France en 1945 jusqu’à sa rupture avec le marxisme à la fin des années 1960 en passant par l’aventure Socialisme ou Barbarie, le lecteur se reportera avec intérêt au long entretien accordé en 1974 à l’Agence de presse Libération et reproduit en première partie de ce recueil. Il éclaire indubitablement la suite, en posant les jalons d’une pensée en perpétuel éveil.
À travers l’événementiel d’un temps chaque fois plus accéléré, Castoriadis démonte ainsi, avec une évidente acuité, les principales caractéristiques d’une « basse époque », celle qui « a inventé ce terme suprêmement dérisoire de “post-modernisme” pour cacher la stérilité éclectique, le règne de la facilité, l’incapacité de créer, l’évacuation de la pensée au profit du commentaire, au mieux, du calembour et de l’éructation le plus souvent ». Cette « basse époque » est bien celle d’une « société à la dérive » où la « privatisation des individus » révèle l’exacte nature – « oligarchique » – des « démocraties » qui la produisent et s’en satisfont, où, de glissement en glissement sémantique, jusqu’au sens des mots se perd, où s’instaure un « temps sans véritable mémoire et sans véritable projet » et où la trivialité et l’insignifiance occupent tout l’espace médiatique.
Qu’on ne s’y trompe pas, cependant. Décryptant les signes annonciateurs du pire – toujours à venir –, Castoriadis ne s’en tient pas au rôle, peu enviable au demeurant, de l’oracle, il s’efforce « de rendre les choses claires », et il y parvient. Car l’autre versant de ces « entretiens et débats » ouvre, non des perspectives radieuses, mais des pistes pour que redevienne possible « l’extrême improbable ». « La philosophie, la vraie pensée, disait-il dans un entretien au Monde de 1986, n’est pas finie. On pourrait presque dire qu’elle commence. Et la grande politique est à recommencer. L’autonomie n’est pas simplement un projet, c’est une possibilité effective de l’être humain. On n’a pas à prévoir ou à décréter son avènement ou son effacement, mais à travailler pour elle. »
Une leçon d’intelligence critique, en somme, que le temps n’a pas infirmée, au contraire. Car l’époque est toujours plus « basse », même si, ça et là, semble pointer, encore modestement, ce retour au politique que Castoriadis jugeait si nécessaire.
Arlette GRUMO
■ Alain PESSIN et Mimmo PUCCIARELLI
PIERRE ANSART ET L’ANARCHISME PROUDHONIEN
Lyon, Atelier de création libertaire, 2004, 128 p.
Pour inaugurer sa nouvelle collection d’entretiens – « Chemins de l’imaginaire politique et social » –, l’Atelier de création libertaire de Lyon a eu l’excellente idée de s’adresser à Pierre Ansart, dont les travaux sur Proudhon sont référence incontournable.
Face à Alain Pessin et Mimmo Pucciarelli, le sociologue se prête au jeu de la mémoire – intime et publique, comme l’établit la règle de cette collection – et nous restitue l’itinéraire qui l’a conduit à s’intéresser à Proudhon et à l’anarchisme.
Histoire d’enfance et de famille, c’est sur un ton chaleureux que P. Ansart, né en 1922, raconte le défilement des jours dans sa maison de Corbeil. Jusqu’à l’irruption de la guerre, cette « expérience incontestable de la domination contre laquelle la résistance s’impose comme une évidence naturelle ». À l’en croire, c’est de là que tout partira pour l’étudiant en philosophie qu’il était, celui-là même qui traçait des « V » sur les murs de Corbeil dans l’espoir de narguer l’occupant.
Pour arriver à Proudhon, il lui faudra passer par Marx. Qui était donc cet « utopiste » ignorant du socialisme scientifique que dénonçait l’auteur du Capital ? Il alla voir et jugea sur pièce. Une révélation. Nommé professeur de philosophie au lycée Albert-Sarrault de Hanoï, en 1950, il restera huit ans au Vietnam, avant de rentrer en France pour s’y consacrer à sa thèse, avec l’idée désormais bien ancrée de « confronter l’œuvre de Marx et l’œuvre de Proudhon, hors de toute polémique partisane, le plus précisément et le plus honnêtement possible ». Cette thèse – Marx et l’anarchisme – sera soutenue dix ans plus tard, en 1969, et précédée, deux ans plus tôt, de la publication d’une Sociologie de Proudhon, qui connaîtra un certain succès de diffusion en 1968.
Maurice Halbwachs, Georges Gurvitch, le soutien aux insurgés algériens, Mai 68... Figures estimées et moments « effervescents » que revisite, dans cette passionnante conversation, un Pierre Ansart très proche de l’ « anarchie positive » de Proudhon et, ce qui ne gâte rien, très modeste sur ses propres mérites.
Freddy GOMEZ