commentaires sur une histoire falsifiée
Le texte que Marianne Brüll a bien voulu nous faire parvenir offre une vision critique du livre de Forment. Il est davantage, cependant. Pour avoir participé de très près à Ruedo Ibérico de 1970 à 1982 où elle assura des tâches de comptabilité, de secrétariat, d’accueil et de traduction, pour avoir été la compagne de José Martínez pendant des années, il constitue un témoignage direct de l’aventure qui nous occupe ici. Et, en cela, il est irremplaçable.
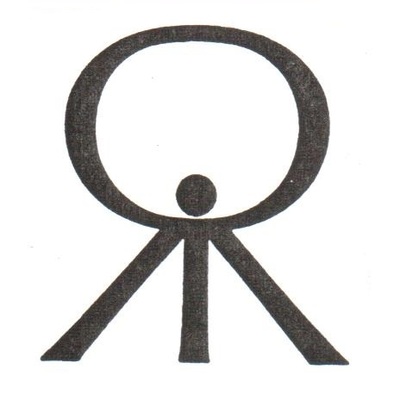
Commençons par le commencement et précisons que le livre de Albert Forment, José Martínez : la epopeya de Ruedo ibérico, édité chez Anagrama, est un ouvrage de commande. Son auteur, bibliothécaire de son état et spécialiste – dit-on – de l’histoire de l’art, a été choisi et généreusement financé par Jesús Amor Martínez Guerricabeitia, le frère de Pepe [1], pour réaliser cette biographie. Précisons encore que Forment lui-même indique, dans son introduction, qu’il n’avait jamais entendu parler auparavant des Éditions Ruedo Ibérico (ERI). Précisons enfin que les deux frères Martínez Guerricabeitia étaient en forts mauvais termes, surtout depuis la tentative d’installation de Pepe en Espagne, qu’ils eurent des parcours personnels et professionnels très différents [2] et que l’adhésion au PCE du commerçant avait, en son temps, irrité le libertaire éditeur. Plus de dix ans après la mort de ce dernier, on aurait pu supposer qu’un retour de fraternité présiderait au travail de mémoire commandé à Forment, ou encore qu’une telle entreprise tenterait de revaloriser l’œuvre de Pepe. À la lecture du livre, il faut bien avouer qu’il n’en est rien.
Au cours de son enquête, j’ai eu l’occasion de fréquenter ce Forment. L’homme avait quatorze ans à la mort de Franco et il appartient à cette génération apolitique du post-franquisme et de la transition. Incapable de saisir, dans ses multiples nuances, ce que fut l’anti-franquisme, il peine bien sûr à comprendre et l’époque qu’il décrit et le creuset que représenta Ruedo Ibérico. Nos rapports, à vrai dire, furent difficiles. Sous influence de son commanditaire, les principaux témoins qu’il consulta relèvent de la catégorie des « anti-Pepe ». Les autres, tous ceux que je lui indiquai, il fut ravi de les rencontrer, mais il n’en tira pas tout le profit qu’on pouvait attendre. Se privant de la possibilité de travailler sur la mémoire orale et de confronter les témoignages, les analyses qu’il nous livre font le reste et nous donnent cet ouvrage aussi confusionniste, vague et light que la triste époque dont il est le fidèle reflet.
Pour pallier la difficulté, Forment décide de se faire fourmi et de travailler sur les archives des Éditions Ruedo Ibérico conservées par l’Institut d’histoire sociale d’Amsterdam. Là encore, il manque de la nécessaire rigueur. Pepe aurait pu tenir un journal, mais il ne le fit pas : il préférait la correspondance. L’homme écrivait beaucoup, énormément et quotidiennement, à des gens très divers avec qui il entretenait des relations plus ou moins personnelles. Pour un chercheur, il s’agit bien là d’un gisement d’informations, mais il faut savoir l’exploiter. Forment y puise abondamment – le livre en témoigne –, mais il en tire peu. En revanche, il omet de consulter les archives administratives. C’est vrai que la tâche était ardue – d’autant qu’il avoue ne pas connaître le français –, mais elle aurait pu l’éclairer sur un certain nombre de choses et lui éviter des interprétations abusives et calomniatrices sur le fonctionnement financier de Ruedo Ibérico. À le lire, en effet, on pourrait s’imaginer que Pepe a toujours disposé des mannes nécessaires – des amis ou du bon peuple – pour être éditeur de renom et se payer beaux costumes et bagnoles, de quoi séduire de nombreuses maîtresses. Le pire, c’est qu’il le croit, Forment, et qu’il admire le « grand éditeur » beaucoup pour cela… Ce qui le dépasse, c’est l’essentiel : l’idée, tout simplement, qu’il fut un temps où certains naïfs pouvaient consacrer leur vie et leur avenir professionnel à une cause, au risque d’y perdre la tranquillité d’esprit et la santé.
Le livre se veut, d’ailleurs, tout public, ce qu’on ne contestera pas. Écrit dans ce style si particulier du journalisme de radio et de télévision, fait de redondances, de sarcasmes et de superlatifs, il n’évite aucun lieu commun. Le Quartier latin que décrit Forment, par exemple, est un poncif à lui tout seul. Sa description sent son provincial espagnol qui connaît, par ouï-dire, Beauvoir et Sartre, « Le Flore » et « Les Deux Magots ». De là à faire comme si Pepe appartenait à cette faune, il n’y a qu’un pas. Or, si Ruedo Ibérico s’y est installé, c’est tout simplement parce que c’était le quartier des libraires et des éditeurs et, dans les années 1950, il était plus préoccupé par les guerres d’Indochine, puis d’Algérie, qu’intéressé par les débats autour de l’existentialisme. Mais Forment s’en tient à l’écume des choses, préférant broder sur l’ignorance.
Dépassé par le personnage et, plus encore, par son œuvre, Forment croit se tirer d’affaire en respectant une stricte chronologie où tout se mêle en un bric-à-brac invraisemblable : vie privée, mentions de livres publiés, nombreux extraits de correspondance, appréciations personnelles et notations politiques. Le tout sans liaison et sans recul. Cela donne un gros compendium (presque 700 pages) assez pénible à lire ou même à consulter, d’autant que l’auteur – bibliothécaire de son état, rappelons-le – n’a pas même été capable d’établir, comme le sujet l’imposait, une bibliographie cohérente et complète. Tout, ici, est à l’avenant. Comment concevoir, par exemple, qu’un historien digne de ce nom et travaillant sur un sujet aussi complexe se contente de l’appareil critique minimaliste (30 pages de références en fin de volume et aucune note explicative) ? Où est la rigueur, dans quel respect Forment tient-il le lecteur quand il cite, tout naturellement, des personnages – dont il devait lui-même ignorer jusqu’à l’existence avant-hier – sans jamais fournir la moindre explication sur le rôle qu’ils jouèrent ? Qui sait aujourd’hui, hormis quelques spécialistes dont ce livre tombera des mains, qui furent Maldonado, Andrade, Llopis [3] et tant d’autres ? Où est le sérieux quand José Peirats est transformé en ministre du gouvernement de Largo Caballero [4], quand il a passé sa vie entière à dénoncer la pratique collaborationniste de la CNT pendant la guerre et qu’il a écrit une monumentale histoire sur cette période, rééditée en 1971 par Ruedo Ibérico précisément ?
L’indigence historique de Forment n’a d’égale que sa confusion politique. Sous les yeux, nous avons une parfaite illustration de ce que pourrait être, concrètement, cette « fin de l’histoire » dont on nous rebat les oreilles. Ici, tout se vaut et tout s’annule : marxisme, anarchisme, communisme, résistance, lutte armée et terrorisme. Comment, partant d’un telle incompétence politique et d’une parfaite méconnaissance de l’anti-franquisme des années 1950 et 1960, s’étonner que l’auteur ne comprenne pas, par exemple, qu’on puisse être anarchiste et avoir retenu des éléments de marxisme tout en étant viscéralement anti-communiste. Comment se surprendre, encore, qu’il cherche une explication à la complexité du personnage en découpant sa vie en tranche : anarchiste au temps de sa jeunesse, philo-communiste à l’âge mûr et de nouveau anarchiste à l’automne de sa vie, tel serait le parcours de Pepe Martínez, d’après Forment qui, perfide, y ajoute une inclinaison, sur le tard, pour la lecture de la Bible [5], selon le témoignage d’un quidam... Ainsi, la boucle est bouclée et les âmes sensibles peuvent respirer en paix : par où Forment passe, la cohérence de toute une vie trépasse !
Mais le bougre n’en reste pas à l’approximation et au commentaire perfide, il se prétend aussi analyste. Et il croit le prouver, en faisant, par exemple, de la création des Editions Ruedo Ibérico une machine de guerre contre le Parti communiste espagnol, ce qui est infondé et absurde. La maison d’édition a été conçue dans un seul but : offrir une information objective et sans censure d’aucune sorte aux Espagnols de l’intérieur, qui n’en disposaient pas sous Franco. Elle n’avait pas d’autre objectif et ne se situait pas par rapport à tel ou tel secteur de l’anti-franquisme. Elle tentait, au contraire, surtout à travers Cuadernos de Ruedo Ibérico [6], de sortir l’analyse politique du ghetto groupusculaire. Si Pepe avait alors cherché la confrontation, elle aurait plutôt eu lieu avec sa famille de pensée d’origine, le mouvement libertaire espagnol, qu’il jugeait sclérosé [7]. Si le travail d’édition entrepris contredisait, à l’occasion, les thèses officielles du PCE, nul n’y pouvait rien. Et, de fait, le reproche que Pepe essuya le plus souvent fut celui de n’avoir pas su donner à sa maison d’édition une ligne politique définie quand, précisément, cette absence de ligne était la seule qui lui convenait. Il affirmait ainsi sa volonté de ne se soumettre à aucun credo en donnant, tout simplement, aux « endoctrinés » (par le franquisme) de l’intérieur de quoi penser. Inutile de préciser que les « endoctrinés » de l’extérieur (les anti-franquistes) ne le comprirent pas toujours. Forment non plus.
À défaut de pertinence historico-politique et de profondeur d’analyse, le biographe sur commande fait dans le factuel et l’histoire-fiction. Pour combler ses manques et justifier ses émoluments, tout lui est bon et aucun racontar ne lui échappe sur la vie amoureuse du « grand éditeur » et la mégalomanie de l’ « autocrate ». Sur le premier point, il n’est pas sûr qu’il y ait grand-chose à dire tant la question de savoir qui Pepe choisissait pour maîtresse est sans intérêt, mais il est impossible de ne pas relever l’étrange goût du chroniqueur pour le détail croustillant, son incroyable légèreté en la matière, et – pour le moins, et c’est le plus grave – l’inélégance dont il fait preuve à foison. Sur le second point, pour avoir participé de très près à l’aventure de Ruedo Ibérico, il m’est impossible de ne pas contredire Forment.
Le cliché de Pepe « autocrate », usé à force d’avoir trop servi, cadre avec son pauvre récit, mais il prouve, surtout, une fois de plus, sa méconnaissance de ce que fut « l’épopée Ruedo ibérico ». On peut s’en tenir à deux témoignages d’ex-employés de Ruedo Ibérico et, sans les confronter à d’autres, étayer un argumentaire que, par avance, on cherchait à établir, mais on ne prouvera jamais rien d’autre ainsi que sa propre mauvaise foi. Il y avait, pourtant, de quoi dire en la matière. Dire, par exemple, que Ruedo Ibérico fut bien une entreprise – d’un drôle de type, certes, mais une entreprise tout de même. Pepe y était, indiscutablement, le patron, mais, là encore, un patron d’un certain type, soit un bonhomme qui n’hésitait pas à sortir de son rôle d’éditeur pour mettre la main à la pâte : décharger les camions, faire les paquets, se taper le travail administratif quand il le fallait. Prétendre qu’il était incapable de déléguer est faux. En vrai perfectionniste, ce qu’il ne supportait pas, Pepe, c’était l’inconséquence. Il ne déléguait qu’à la condition d’avoir la certitude que le travail serait fait et bien fait. Or, pour que la chose soit possible, il faut, c’est sûr, pouvoir compter sur des gens capables et, malheureusement, il faut bien avouer que les employés de Ruedo Ibérico n’eurent pas tous, et de loin, la compétence nécessaire et les qualifications requises pour que Pepe pût leur déléguer grand-chose. D’où la réputation d’ « autocrate » que reprend à son compte Forment, sans chercher à comprendre d’avantage ce qu’était le fonctionnement de Ruedo Ibérico. Quand, par ailleurs, les affaires vont mal, comme ce fut souvent le cas, l’ « autocrate » devient de surcroît, et par obligation, licencieur, ce qui avive toujours certaines haines qui peuvent être tenaces... Si Forment relève un cas – qui n’est pas aussi clair qu’il le prétend, d’ailleurs – d’infiltration policière parmi les employés de la librairie, il y en eut d’autres. Ruedo Ibérico représentait pour le franquisme une dangereuse entreprise de déstabilisation. Tous les moyens étaient bons pour l’abattre [8]. Cela, on peut le comprendre. Ce qu’on admet moins, c’est l’envie – ou la jalousie – qui se saisit de certains associés de l’entreprise et qui les poussa à se croire aptes à remplacer l’ « autocrate ». Il eût fallu, pour ce faire, disposer du sang-froid, de l’esprit de décision, de la lucidité, de l’indépendance et du sens critique nécessaires, mais aussi accepter de s’user à la tâche pour un salaire assez largement sous-évalué en regard des responsabilités contractées. Qu’importe ! Seule semble compter, pour Forment, la réputation de Pepe et il n’a cure que celle-ci repose sur du sable. Ainsi, ce reproche de mauvais gestionnaire que d’aucuns se sont évertués de colporter ici et là avec constance et que, bien sûr, rapporte Forment. Il en fut même qui prétendirent que ERI ne pouvait sortir du marasme économique où elle stagnait qu’en devenant une coopérative autogérée. Outre le fait que la solution proposée démontrait une curieuse incompréhension des causes réelles des difficultés financières de l’entreprise [9], elle dissimulait mal l’enjeu de pouvoir qui la justifiait : il s’agissait ni plus ni moins de faire en sorte que la décision éditoriale, en la diluant, échappât à Pepe et que tout un chacun devînt éditeur. Les quelques « bidons » que, par faiblesse ou pour faire plaisir à ses commanditaires associés, Pepe accepta d’éditer donnent une idée assez précise de la pente fatale sur laquelle aurait glissé ERI à céder à leurs démagogiques injonctions. Comme il n’y accéda point, ses adversaires se chargèrent de sa réputation. Forment, à sa façon, y contribue assez largement. En somme, il s’agit bien de détruire à défaut d’avoir construit, de détruire par envie. Pepe en souffrit toute sa vie. Un dicton espagnol résume la chose à merveille : no come ni deja comer…
Sur le même sujet et en guise de conclusion, je ne peux pas accepter que Forment se permette de qualifier Luciano Rincón et Jesús Ynfante [10] d’écrivains « appointés ». Le premier a passé quelque cinq ans dans les prisons franquistes pour le seul fait d’avoir été édité par Ruedo Ibérico. Le second est arrivé un jour à Paris avec, sous le bras, un manuscrit explosif sur l’Opus Dei. Pour qu’ils puissent, l’un comme l’autre, se consacrer à leurs travaux d’investigation, Pepe leur versait, par mensualités, une sorte d’avance sur leurs droits d’auteur. Que Forment y trouve quelque chose à redire, c’est son problème, mais signalons qu’il n’est pas le plus indiqué pour cela. À la différence de Rincón et d’Ynfante, ses appointements de biographe à gages sont, eux, sans commune mesure avec les risques encourus.
Quel bilan tire Forment de l’aventure Ruedo Ibérico ? Quelle importance accorde-t-il à tel ou tel ouvrage par rapport à tel autre ? Sur ce thème, pourtant central quand on prétend faire œuvre sur « l’épopée Ruedo ibérico », rien. Un magma indifférencié. Il s’appesantit, par exemple sur les à-côtés du livre de Garcia Venero [11], sur le sort du Meynaud ou sur l’échec du projet de dictionnaire [12], pour s’adonner à son penchant pour l’anecdote ou pour piller la correspondance de Pepe, mais ne mentionne qu’à peine – ou très évasivement – des ouvrages dont l’importance est, aujourd’hui encore, reconnue. La manœuvre est claire : tout ce qui tendrait à prouver la mauvaise réputation de Pepe (entêtement, dilapidation d’argent, caprices, etc.) est bon à prendre. En revanche, ce qui atteste de ses évidentes qualités d’éditeur – entre autres, ce flair qu’il avait pour trouver l’auteur capable de traiter de tel ou tel sujet – est définitivement écarté. Forment, par exemple, ne saisit pas le réel intérêt de nombre de suppléments à Cuadernos de Ruedo Ibérico, comme España hoy (1964), Horizonte español (1966 et 1972), Cuba, una revolución en marcha (1968) ou El movimiento libertario español (1974) [13]. Il s’agit pourtant là de compilations importantes, d’ouvrages thématiques surgis de l’actualité, qui prouvent à eux seuls la conception que Pepe se faisait du métier d’éditeur. Forment devait avoir la tête ailleurs...
À l’impossible nul n’est tenu, pourrait-on avoir la faiblesse de dire, en cherchant des excuses à Forment sous prétexte que son livre aurait le mérite de tirer Ruedo Ibérico de l’oubli. Certes. Admettons, cependant, que l’oubli est un tiroir à double fond. Il faut non seulement l’ouvrir, mais y faire le tri entre l’accessoire et l’essentiel. Pour Pepe, l’essentiel, c’était, à n’en pas douter, le travail fourni et l’œuvre réalisée. C’est ainsi qu’il conçut sa vie d’exilé et qu’elle se confondit avec Ruedo Ibérico. De n’avoir pas su le saisir et le faire comprendre, Forment n’est pas allé contre l’oubli, mais contre ses apparences. Il est un auteur de cette époque, vague, confuse et satisfaite. L’histoire de Ruedo Ibérico reste à faire.
Marianne BRÜLL
