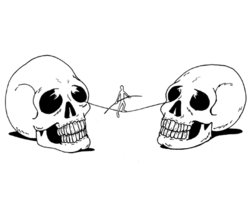
■ Bella et Roger BELBÉOCH
TCHERNOBYL, UNE CATASTROPHE
(Quelques éléments pour un bilan)
Paris, Éditions La Lenteur,2012, 310 p.
L’accident dans la centrale de Fukushima-Daiichi, survenu le 11 mars 2011 au Japon, et classé peu après au niveau 7 sur l’échelle INES (International Nuclear Event Scale) – tout comme celui de Tchernobyl –, a durant quelques semaines ébréché le consensus nucléariste en France, pourtant le pays le plus nucléarisé du monde, et réveillé quelques inquiétudes, vite oubliées. Il faut dire que l’État, le lobby nucléaire et les médias ont fait, comme à leur habitude, le maximum pour anesthésier le plus rapidement possible l’angoisse diffuse de l’opinion publique et les questions gênantes qu’elle aurait pu se poser. Pourtant, à cette occasion, quelques livres ont tenté d’éclairer leurs lecteurs sur cette catastrophe et de revenir sur la question du nucléaire [1].
Parmi ces titres, la réédition revue et augmentée de Tchernobyl, une catastrophe mérite une attention particulière tant par la personnalité de ses auteurs que par leur façon d’aborder la place du nucléaire dans nos sociétés comme sur les moyens de s’y opposer. D’abord publié dans la revue L’Intranquille, en 1992, puis en volume l’année suivante aux éditions Allia, cette nouvelle édition se distingue par une roborative préface due à Cédric de Queiros et l’ajout de deux textes : l’un de Bella Belbéoch – « Responsabilités occidentales dans les conséquences sanitaires de la catastrophe de Tchernobyl, en Biélorussie, Ukraine et Russie » –, l’autre de Roger Belbéoch – « La société nucléaire », tiré de l’Encyclopédie philosophique universelle. Les Notions philosophiques (PUF, 1990).
Tous deux physiciens et ingénieurs de l’École supérieure de physique et de chimie de la Ville de Paris, Bella a travaillé au Centre d’études nucléaires de Saclay (Commissariat à l’énergie atomique) et Roger dans un laboratoire universitaire de recherche d’Orsay. Nés en 1928, ils appartiennent à une génération de scientifiques qui participent au mouvement antinucléaire dès les années 1970 [2]. Ainsi Bella participe au Groupe Information Travail de Saclay, créé en 1974 par des physiciennes, qui enquête sur les conséquences sur la santé des travailleurs dans un centre nucléaire. Peu après, l’appel de quatre cents physiciens, rejoints rapidement par quatre mille scientifiques, rencontre un écho national, voire international, et inquiète le gouvernement et les promoteurs du programme électronucléaire : la critique n’est plus le seul fait de « gauchistes irresponsables » ou d’ « individus incultes mus par des peurs irrationnelles », mais gagne en légitimité et en crédibilité grâce à ces savants. Dans cette optique, est créé, en 1975, le Groupement des scientifiques pour l’information sur l’énergie nucléaire (GSIEN), une association regroupant des scientifiques indépendants qui diffuse de l’information sur les questions soulevées par le développement de l’industrie nucléaire en France. Il publie un journal, La Gazette nucléaire, dont le premier numéro paraît en 1976 et qui existe encore aujourd’hui. Les Belbéoch seront de l’aventure et donneront de nombreux articles à cette publication tout en participant également au Comité antinucléaire Stop Nogent-sur-Seine et à sa lettre d’information. Après la mort de Roger Belbéoch, le 27 décembre 2011, un physicien suisse membre du GSIEN, qui assista longtemps aux assemblées générales de cette association, « qui regroupait des personnalités aux positions plus ou moins radicalement opposées à l’électronucléaire », note : « Parmi les plus radicaux figuraient les époux Belbéoch dont j’appris à apprécier la rigueur intellectuelle, la chaleur humaine et le courage, car il en faut pour être dissidents dans l’establishment scientifique français. » Auteurs de nombreux articles, souvent conjointement, parfois séparément, dans la Gazette nucléaire mais aussi dans la Lettre d’information du Comité Stop Nogent-sur-Seine, ainsi que dans la revue Stratégies énergétiques, biosphère & société (SEBES), publiée à Genève dans les années 1990 [3], Roger et Bella Belbéoch ont aussi écrit Sortir du nucléaire, c’est possible avant la catastrophe (1998) et Tchernoblues. De la servitude volontaire à la nécessité de la servitude (2002).
Selon son préfacier, Tchernobyl, une catastrophe est « la meilleure étude historique » sur cet événement et ses conséquences. La lecture, ou la relecture, de ce livre confirme ce propos. D’emblée, le lecteur est confronté à un rapprochement entre Hiroshima et Tchernobyl. En quelques décennies, on est passé d’un enthousiasme délirant et général – à quelques notables exceptions près comme Albert Camus, en France, ou Lewis Mumford, aux États-Unis – pour ce que l’on croyait être une source inépuisable d’énergie à une situation où il convient avant tout de « camoufler l’ampleur du désastre ». En 1986, Tchernobyl, qui est « une catastrophe bien particulière », met fin aux « illusions mystico-scientifiques » nées en 1945 : « Avec l’industrie nucléaire, les accidents industriels prennent de nouvelles dimensions dans l’espace et dans le temps. » Ils annoncent une époque « où les experts scientifiques ne peuvent plus rien promettre d’autre que la gestion des catastrophes », leur pouvoir menaçant de s’installer d’une façon inéluctable grâce à elles. Et ces experts, ou prétendus tels, ont démontré à cette occasion un cynisme rare et un mépris sans égal pour les populations auxquelles ils sont censés garantir le bien-être, la santé et la sécurité. Sans parler de l’inénarrable professeur Pellerin qui est devenu une sorte de type idéal de l’amoralisme et du mensonge d’État – un genre pourtant très couru –, rappelons, parmi beaucoup d’autres, la déclaration du directeur de la sûreté nucléaire de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AEIA), une agence pour sa promotion issue de l’ONU, en août 1986 : « Même s’il y avait un accident de ce type tous les ans, je considérerais le nucléaire comme une source d’énergie intéressante. » Quant aux experts qui prennent les choses un peu trop à cœur, il ne leur reste plus que le suicide. Ainsi, Valeri Legassov, physico-chimiste membre de l’Académie des sciences de l’URSS et parmi les promoteurs du programme nucléaire soviétique, se donne la mort en 1988, le jour anniversaire de la catastrophe. Dans un important testament publié dans la Pravda (20 mai 1988), il critique « la façon dont les organismes officiels ont depuis longtemps traité les problèmes de sûreté nucléaire » et constate son échec personnel à modifier les pratiques du monde nucléaire. Autre illustration de ce cynisme sidérant : l’invention d’une prétendue « radiophobie » pour expliquer les problèmes sanitaires. Ceux-ci n’étaient pas dus aux conséquences de la catastrophe, mais à une crainte irraisonnée de la population d’être soumise à d’illusoires radiations. On a rarement fait mieux – mais ne désespérons pas ! – et, depuis, les experts ont remisé ce « concept » sous le tapis, mais le seul fait qu’il ait été utilisé, discuté et commenté avec le plus grand sérieux par des experts d’institutions internationales en dit long sur la confiance que l’on peut accorder à ceux qui l’ont utilisé.
Comme l’écrivent les Belbéoch, « pour ceux qui doivent participer à la gestion des crises nucléaires, il est clair qu’un accident majeur se définit non par ses conséquences objectives (sur lesquelles il y a peu de prise), mais par ses conséquences médiatiques. Ainsi, gérer un accident majeur, c’est essentiellement gérer ses conséquences médiatiques ». Et parmi elles, il fut facile d’imputer la catastrophe à l’incompétence bureaucratique et au retard technologique des autorités de l’ex-URSS. Non, décidément, cet incident regrettable ne pouvait pas arriver dans un pays développé doté d’une haute technologie ! On sait, depuis, avec Fukushima, ce qu’il en est advenu… Tout le travail des Belbéoch consiste à renverser la perspective en dissipant les faux-semblants médiatiques pour prendre la véritable mesure des conséquences objectives d’une telle catastrophe…
L’un des principaux mérites de leurs travaux est de considérer le nucléaire comme un projet de société qui, si la population – donc les victimes potentielles – ne s’en mêle pas et ne le conteste pas, aboutira peu ou prou à une forme inédite de totalitarisme. L’autre mérite, qui sera omniprésent dans leurs travaux ultérieurs, est une critique sans concession des milieux antinucléaires et de leur échec à s’opposer efficacement à la poursuite du programme électronucléaire français. Ils dénoncent, en particulier, la duperie d’une sortie différée du nucléaire sur un quart de siècle qui « permet de concilier une attitude apparemment antinucléaire avec des forces pro-nucléaires afin d’aboutir à des alliances électorales dont le seul but est d’assurer des élus et non une stratégie antinucléaire » [4]. Ils soulignent également que les luttes partielles qui ont réussi – Plogoff, Le Carnet – ont été limitées à un « pas dans mon jardin ! ». Elles n’ont pas été globalisées pour contester le programme électronucléaire en lui-même, alors que toute catastrophe nucléaire a, et aura pendant longtemps, des conséquences aux niveaux national et international, comme l’a prouvé Tchernobyl. Car, pour Bella et Roger Belbéoch, « c’est avant l’accident qu’il faut agir ; après, il n’y a plus qu’à subir ». Lire, relire et faire connaître Tchernobyl, une catastrophe est un premier pas dans ce sens.
Henri BLANC
