■ Guy DEBORD
CORRESPONDANCE
(Volume 5, janvier 1973 - décembre 1978)
Paris, Fayard, 2005, 504 p.
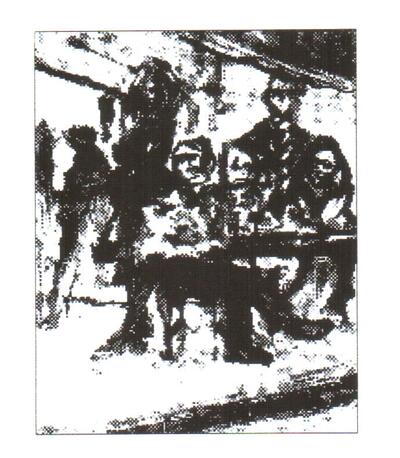
Un temps, Florence fit les délices de Guy Debord. Il y séjourna, il y croisa quelques êtres singuliers, il y cultiva son goût de la subversion. En date du 25 mars 1974, pourtant, une lettre à Gianfranco Sanguinetti sonne comme un signal : « Il y va d’une ville véritable comme de l’IS : il lui faut être bien peuplée, sinon elle n’a qu’à disparaître. » La page, alors, n’est pas loin d’être tournée. Subrepticement, l’Oltrarno devient, pour Debord, un autre lieu de sa mémoire, au même titre que le Paris du temps des « plus heureux désordres ». Quant au caro compagno, encore très présent dans le cinquième volume de sa Correspondance, il cesse progressivement d’être l’interlocuteur privilégié. Trop de divergences et d’incompréhensions se sont installées entre eux. « Je ne condamne jamais des individus, lui écrit Debord le 23 mars 1974, qu’en considérant ce qu’ils ont, par mérite ou par chance, connu de mieux, en eux-mêmes et au-dehors, et ce qu’ils en ont fait (ou pas fait). » Il y a de la déception dans tout cela. La rupture viendra plus tard. Entre 1973 et 1978, l’Italie fournit encore à Debord l’occasion d’énoncer quelques jugements bien sentis sur la crise qu’elle traverse – le terrorisme et l’affaire Moro, notamment [1] –, mais elle n’est plus qu’un sujet parmi d’autres, beaucoup moins investi sentimentalement que d’autres – le Portugal, par exemple. Autrement dit, une fois la passion éteinte, l’Italie redevient, pour Debord, une pièce d’un plus vaste échiquier où, malgré quelques glorieuses résistances, le « spectacle » est sur le point de l’emporter sur sa négation. On y verra peut-être une lecture partiale, mais il fait peu de doute, à nos yeux, que ce cinquième volume de la Correspondance marque, sur les autres, une différence : Debord y envisage désormais le repli, mais pour mieux continuer à déplaire.
Dans une lettre adressée à Bernard Schumacher et Juvénal Quillet, le 25 février 1975, Debord s’exprime ainsi : « J’ai pris depuis longtemps diverses mesures pour supprimer toute base d’un spectaculaire organisationnel, ou semi-organisationnel dans lequel je pourrais me trouver impliqué. Je n’entends donc garder de contact qu’avec mes amis personnels, et d’autres individus collaborant à certaines activités pratiques que je juge suffisamment importantes, et qui pour cela n’ont pas besoin de s’afficher publiquement. » Un de ces « individus » – l’éditeur Gérard Lebovici – finira par devenir un ami sûr.

On a beaucoup glosé sur ce qui avait bien pu réunir Debord et Lebovici et sur l’influence, forcément manipulatrice, qu’aurait exercée le premier sur le second. Sur ce sujet, la correspondance de Debord ouvre, pour qui la lit sans œillères, quelques pistes intéressantes. Dans la lettre à Schumacher et Quillet déjà citée, il pose les prémices de cette connivence : « J’ai la plus grande estime pour Lebovici, estime fondée sur l’expérience de ce que, depuis que le connais, je l’ai vu successivement entreprendre et mener à bien, dans toutes les affaires où j’étais concerné. » C’est l’estime, ici, qui est à la base de tout, une estime mise à l’épreuve des faits, pourrait-on dire. Sur ce point, la manière – expéditive – dont Lebovici reprit la main sur Champ libre en virant ses premiers collaborateurs [2] eut l’avantage de ravir Debord. Ainsi, il écrit à Sanguinetti, le 10 décembre 1974 : « Je viens de voir Lebovici, qui est de mieux en mieux. Il avait demandé la démission des quatre bureaucrates, comme je le lui avais conseillé. (...) Depuis la mort d’Alexandre, on n’avait pas vu l’écroulement si soudain d’un empire ! (...) » Les limogés, bien sûr, s’empressèrent de rendre Debord responsable de leur triste sort et de le dépeindre en satanique inspirateur d’un Lebovici subjugué. L’hypothèse, largement colportée depuis, repose, pourtant, sur un présupposé contestable : la faiblesse de caractère du patron. Tout laisse à penser, au contraire, que Lebovici possédait et la capacité et des motifs suffisants pour se séparer de ses employés. Que, sur ce plan, Debord l’ait incité à ne pas faiblir, la cause est entendue. C’est que, pour lui, le gauchisme contre-culturel incarné jusqu’à la caricature par la bande à Guégan représentait tout ce qu’il détestait, tant en matière de choix éditoriaux que d’esthétique criarde [3]. Pour le reste, on peut s’en remettre à l’opinion pertinente exprimée par Vincent Kaufmann dans son livre consacré à Debord [4] : l’amitié qui naquit entre les deux hommes eut pour effet « de radicaliser non seulement les positions politiques, mais aussi les pratiques de Lebovici ». Quant à Debord, il eut sur les « truqueurs » de Champ libre l’avantage de juger Lebovici à sa juste valeur, intellectuellement et humainement parlant s’entend.

Dès lors, Champ libre seconde manière pouvait commencer. « L’hostilité très active que cette maison d’édition rencontre partout de la part des milieux de la falsification contemporaine l’honore certainement, et même l’identifie dans une assez large mesure au parti de la vérité. Elle mérite donc en tant que telle(mais pas davantage, et surtout pas totalement) d’être approuvée et défendue par les révolutionnaires contemporains, bien plus qu’elle n’aurait, elle, à approuver et soutenir ces révolutionnaires partout où il sont. » Ces mots, extraits d’une lettre adressée à Jaime Semprun, le 26 décembre 1976, disent assez la façon dont Debord entend les rapports entre Champ libre et les « révolutionnaires » : ni fascinés ni complaisants. Quant au rôle, indéniable, qu’il y joua, il eut toujours tendance à le minimiser. « Quoique certains puissent dire, écrit-il encore à J. Semprun, je ne suis pas le Weltgeist [5] assis derrière les bouteilles, et Champ libre n’est pas ma création (...). Dans cette maison d’édition (...), je ne suis ni associé ni employé. Je n’y exerce donc aucune “coresponsabilité ”, ni générale, ni particulière, n’ayant là strictement vis-à-vis de qui que ce soit – le propriétaire, les auteurs ou le public – ni droit, ni devoir, ni fonction. » Ailleurs, il affirme n’être « jamais intervenu pour “faire refuser” des textes, mais seulement positivement pour en “faire passer” » et n’avoir conseillé qu’à titre « tout à fait gracieux ».
Ces conseils, le volume 5 de la Correspondance en offre quelques précieux exemples. À propos d’une éventuelle publication de l’ouvrage de Gracian Le Politique Dom Ferdinand le Catholique, jugé « infiniment inférieur » à L’Homme de cour et n’égalant pas Le Héros, Debord fait part de son hésitation à Lebovici, tout en affirmant ne pas sous-estimer « l’intérêt d’être provocant par rapport aux goûts actuels pour le sous-langage parlé » (14 juillet 1976). À propos de Bruno Rizzi, dont L’URSS, collectivisme bureaucratique paraîtra en décembre 1976, il s’enflamme : « Voilà le livre le plus inconnu du siècle, et c’est justement celui qui a résolu, dès 1939, un des principaux problèmes que ce siècle a rencontrés : la nature de la nouvelle société russe, la critique marxiste de la forme de domination bureaucratique qui y est apparue » (29 septembre 1976). À propos de Clausewitz, encore, ou des Ricordi, de Francesco Guicciardini. Dans une lettre à J. Semprun, déjà citée, Debord reconnaît avoir « conseillé à Lebovici la publication d’une dizaine de titres du passé », jugés « importants » et seulement deux titres d’auteurs contemporains : Le Véridique Rapport, de Censor (Sanguinetti) et La Guerre sociale au Portugal, dudit Semprun.
Au chapitre des rares coups de cœur « littéraires » de Debord, enfin, sa correspondance nous révèle son admiration pour les Mémoires de Retz – que nous connaissions déjà –, pour les Souvenirs de Tocqueville, pour La Catalogne libre, d’Orwell – le livre « le plus véridique sur la révolution espagnole » –, pour Le Labyrinthe espagnol, de Gerald Brenan, et pour Bakounine et les autres (esquisses et portraits contemporains d’un révolutionnaire), présenté par Arthur Lehning [6].

S’il est un domaine dans lequel Debord excella dans l’art du déplaisir et de l’hostilité, c’est à l’évidence celui de l’image. Car l’anti-cinéma qu’il pratiqua délimite à un point tel le cadre de ses détestations, de ses négations et de ses refus qu’on comprend, à voir ses films [7], qu’il préférât, comme le souligne V. Kaufmann, qu’on le dise « cinéaste plutôt qu’écrivain ou autre chose encore » [8]. Cinéaste en guerre contre le spectacle et le « spectateur contemporain », Debord le fut pour beaucoup, entre 1973 et 1978, grâce à Lebovici, qui lui permit de réaliser trois œuvres majeures dans sa filmographie : La Société du spectacle (1973), Réfutation de tous les jugements, tant élogieux qu’hostiles, qui ont été jusqu’ici portés sur le film « La Société du spectacle » (1975) et In girum imus nocte et consumimur igni (1978).
« Il paraît (...), écrit Debord, à propos de la version filmée de La Société du spectacle, que des puristes sont étonnés et choqués – non des thèses du livre, qu’ils prétendent toujours approuver –, mais que j’aie fait un film si riche, si visiblement “superproduction”... C’est bien que les films impressionnent plus que les livres. Je m’en réjouis. » [9] L’idée est donc bien de confondre les faussaires, de leur faire ravaler leurs fadaises respectueuses, de les contraindre au scandale. « On fera encore pire la prochaine fois », annonce-t-il à Sanguinetti le 11 juin 1974. Et, dans la foulée, le 18 juin, Debord s’ouvre d’un nouveau projet à Lebovici : « Il serait bon de faire un court métrage consacré à la réfutation de toutes les critiques énoncées, et aussi bien de celles qui se sont imaginées favorables, mais avec une égale incompétence. » Ce sera Réfutations... La guerre, toujours.
Le volume 5 de la Correspondance indique, dans le détail, l’importance que Debord accordait à ses films et le sérieux avec lequel il les préparait. Achevé en octobre 1978, In girum... ne sortira sur les écrans qu’en mai 1981. Il y restera peu de temps. Le 8 mai 1978, Debord écrivait à Lebovici : « Le cinéma me paraît fini (...) Je crois qu’une telle époque ne mérite pas un cinéaste comme moi. Elle a tout fait pour le prouver – et nous aussi ! De même qu’il y aurait eu de la faiblesse à en faire moins, il y aurait certainement de la faiblesse à insister dans une position si purement négative, avec de trop longs discours. » In girum... sera son dernier film. En octobre 1983, Lebovici achètera le Studio Cujas, petite salle du Quartier latin, pour y montrer les films de Debord. Une histoire d’estime et d’amitié, encore.

« L’époque ne demande plus seulement de répondre vaguement à la question “Que faire ?” (...) Il s’agit maintenant, si l’on veut rester dans le courant, de répondre, presque chaque semaine à cette question : “Que se passe-t-il ?” » [10] Cette interrogation occupe une place centrale dans une correspondance riche en commentaires – drôles, cassants, pointus ou hardis – sur une actualité par ailleurs plus souvent terne qu’exaltante. Seule exception, ou presque, le Portugal de ladite « révolution des Œillets », qui, un temps bref, redonna des couleurs au vieux rêve émancipateur.
Dans une lettre à Afonso Monteiro en date du 8 mai 1974, Debord écrit : « Au Portugal maintenant, tout peut arriver, mais pas n’importe comment. (...) Pour l’instant, les masses ne sont armées que d’espoirs et, je l’espère, d’exigences. Beaucoup va dépendre de la qualité de ces exigences. » À ses yeux, « la beauté baroque de la situation présente » ne saurait faire illusion : « Le Portugal connaît une “libération”, non une révolution ». Quant au capitalisme, dont la modernisation est au programme, il a deux cartes précieuses à jouer : l’armée et « la bureaucratie en formation rapide des partis et des syndicats ». Le 16 juillet, dans une lettre à E. Rothe cette fois, il croit percevoir « la fin de “la belle révolution”, comme disait Marx à propos de la période février-mai 1848, la fin du moment où toutes les classes pouvaient croire, ou feindre de croire, qu’elles étaient d’accord, et contentes, simplement sur la joyeuse liquidation du salazarisme ». L’heure, désormais, est au saut qualitatif, et celui-ci dépend de la capacité des prolétaires à prendre les choses en main.
Ce Portugal en mouvement, Debord l’observe de loin, de l’ombre qu’il s’est désormais choisie, refusant de céder aux sollicitations d’Afonso Monteiro et de ses amis, qui l’incitent à s’y rendre. « Je trouve (...), leur écrit-il le 15 novembre 1975, que votre manière de m’appeler à “venir voir” ce que vous voyez vous-mêmes dans une sorte de silence ébloui, ne débouche pas seulement sur quelque chose d’inutile, mais sur quelque chose qui n’est même pas innocent. » Leur reprochant, entre autres choses, leur « triomphalisme abstrait » d’ « admirateurs quasi passifs », il espère qu’il leur « reste assez de sens historique pour [leur] interdire l’euphorie à ce point ». Car, pour Debord., c’est d’abord « l’extrême et burlesque faiblesse de la contre-révolution au Portugal, association universelle de tous les pouvoirs en dissolution, des généraux salazaristes aux staliniens et gauchistes » qui explique que « le processus » révolutionnaire ait pu se développer. Croire qu’il est sur le point de vaincre est une autre affaire. Il n’a, pour sa part, pas plus cédé au tourisme révolutionnaire qu’au lyrisme barricadier.

Dans cette même lettre à Monteiro et à ses amis, Debord s’exprime ainsi : « Il existe des gens, pour moi en bien petit nombre, qui méritent d’être suivis très loin, et sans autres bonnes raisons, simplement parce que l’on reconnaît en eux une certaine qualité de vie possible (et alors, c’est tout à fait comme pour les révolutions, il faut faire pour eux tout ce que l’on peut effectivement). » Cette attention aux êtres n’a d’égale, chez Debord, que son aspiration au « vivre bien ». La première perce, ici et là, quand la mort d’Asger Jorn ou le suicide de Michèle Labaste, sa demi-sœur, le laissent inconsolé, mais aussi quand la confidence amoureuse ou érotique ouvre sur une éthique de l’autonomie et de la générosité. La seconde affleure, par touches successives, dans son éloge du Minour, la maison de Champot, où il s’est replié du monde pour mieux en comprendre les sinistres mutations. « Tous les soirs, écrit-il à Lebovici, le 8 mars 1978, on entend le cri de l’oiseau de Minerve dans les bois qui nous entourent. Comme “la sagesse ne viendra jamais”, il est réconfortant de savoir qu’elle ne réside pas trop loin. » Vivre bien, pour Debord, c’est tenir le « mensonge du pouvoir » à distance et partager le vin de l’amitié avec qui sait s’en montrer digne. Quant à lui, il n’a jamais douté de ses propres mérites. La preuve : « Je trouve qu’il est assez normal que les gens qui me fréquentent aient parfois l’esprit d’en tirer parti (...) J’ai eu sans doute de l’influence sur beaucoup de gens, mais j’ai toujours vu que ceux sur lesquels j’avais le plus d’influence étaient les personnalités les plus autonomes et les plus capables d’agir (de sorte que cette influence ne reste sûrement pas unilatérale). À l’autre extrémité du spectre, plusieurs se sont contentés de pouvoir dire qu’ils m’avaient vu. » [11]
Freddy GOMEZ
