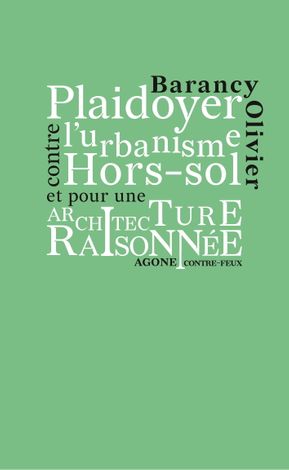
■ Olivier BARANCY
PLAIDOYER CONTRE L’URBANISME HORS-SOL
ET POUR UNE ARCHITECTURE RAISONNÉE
Agone, « Contre-feux », 2023, 192 p.
On se souvient – ou pas, la mémoire finit par devenir volatile quand une catastrophe chasse l’autre, et c’est fréquent par les sales temps qui courent – de l’effondrement de deux immeubles de la marseillaise rue d’Aubagne, artère du très populaire quartier de Noailles, le 5 novembre 2018. Les lieux étaient jugés « en très mauvais état » par des autorités municipales depuis plus d’un demi-siècle. Une paye ! Comme quoi, le malheur est prévisible, mais pas les moyens de l’éviter : la réhabilitation, pour le cas. Je ne sais pas pour vous, lecteurs, mais pour moi cette horreur – huit morts en temps de paix sous des ruines – disait beaucoup d’une époque. Quelques jours plus tard, des pauvres, la plèbe, la lie, des gueux, à Marseille comme ailleurs, occuperaient les ronds-points des villes et des villages pour faire de leur misère le fondement d’une révolte au long cours contre la « tête de con », ses clones et son monde.
Architecte de son métier, spécialiste des immeubles anciens, grand connaisseur de l’Art nouveau, déjà auteur chez Agone de Misère de l’espace moderne : la production de Le Corbusier et ses conséquences (2017) et traducteur en 1996 pour L’Encyclopédie des nuisances de L’Âge de l’ersatz, du formidable William Morris, Olivier Barancy fait de ce drame de la rue d’Aubagne, auquel le prologue de son livre est consacré, l’entrée en matière d’un désastre général. Clair, sans fioritures, il pointe les responsables de l’effondrement de la rue d’Aubagne : les marchands de sommeil, les bailleurs, la municipalité et la préfecture – donc l’État. Et pas la pluie, comme le prétendit l’infâme édile de la cité phocéenne, ce mafieux Jean-Claude Gaudin à l’époque.

Olivier Barancy se situe dans la tradition de la common decency d’Orwell et de l’économie morale de Thompson. Architecturalement parlant, cela pourrait s’exprimer ainsi : cesser de détruire – ou de laisser s’effondrer – les traces du passé des villes – leurs bâtiments – pour, au contraire, les cultiver, en réhabilitant les lieux d’habitation dans un cadre où l’espace urbain serait pensé comme lieu de vie. Brillant, foisonnant, son essai dénonce les fausses solutions urbanistiques en vogue chez les décideurs du moment – entre villes dites intelligentes et écocités – et dénonce ces architectes du néant qui, appointés au juste prix de leurs coûteux égos, défigurent sur plan le visage de villes qui, numériquement pensées par eux, n’inspirent que le désir de les fuir.
Sa force, c’est d’aller au-delà de la dénonciation et du cri du cœur en inscrivant sa démarche dans le cadre plus général du capitalisme de destruction qui unifie, aujourd’hui, le monde : car le monde est hégémoniquement capitaliste – sous formes privée ou étatique, fossile ou numérisée. Longtemps, nous dit Barancy qui brosse large, l’architecture se passa d’architectes. Elle fut « vernaculaire » et anonyme, prise en charge par des bâtisseurs du commun dépourvus de toute idéologie architecturale, réinventant en permanence des gestes ancestraux, utilisant des matériaux locaux et sachant adapter leurs constructions aux aléas de leur environnement. C’est durant l’entre-deux guerres que l’architecture va devenir matière de spécialistes et être théorisée comme telle, c’est-à-dire conceptualisée comme catégorie séparée de l’acte de bâtir pour le seul bien commun. En ce sens, Le Corbusier et le Bauhaus, dans des optiques aussi différentes bien sûr que celles qui mirent en rivalité – au lendemain de la Première Guerre mondiale – les fonctionnalistes et les partisans de l’Art déco, s’inscrivent dans un même mouvement d’époque où l’expertise épouse des impératifs de rationalisation, de standardisation et de modernisation.
Reste que, pour Barancy, la vraie césure entre ce qu’on appela l’architecture moderne et celle qui sévit dans notre contemporanéité date des années 70 du siècle dernier. Trois événements, nous dit-il, permettent cette datation : la destruction volontaire, en 1972, d’un groupe de logements sociaux réputé invivable à Saint Louis (Missouri) ; la fin du modèle d’habitat collectif en grands ensembles comme conséquence de la crise pétrolière de 1974 ; l’irruption du « paquebot spatial » et muséal du Centre Georges-Pompidou en plein cœur du Paris historique, en 1977.
Ce qui définit désormais l’ « architecture contemporaine », nous dit l’auteur, c’est une « impressionnante perte de la valeur d’usage », le passage au dessin et à la conception assistés par ordinateur, la bureaucratisation du métier, la prégnance des bureaux d’études et des agences supranationales. On comptait, en 2010, 30 000 architectes dépossédés de leur vrai métier car ne produisant, in fine, que des images pixellisées. En ce sens, devenu « artiste contemporain » ayant rejoint la faune d’avant-garde d’un « académisme à rebours » (Mircea Eliade) favorisant de grosses plus-values pour les Jeff Koons de l’escroquerie marchande, l’architecte ne se préoccupe plus « de la destination de l’édifice, ni des usagers, ni de son insertion dans l’environnement ». « Drapé dans son ego » de petit maître d’œuvre d’un « marché porteur », il compte ses royalties en espérant faire pire la prochaine fois. Normal : le pire est la condition du néant qu’il habite.

Ce pire, on devrait s’en être aperçu, est sans limites, comme la prétention des pseudo-bâtisseurs de la postmodernité triomphante à être de leur temps. Contre la congestion des villes par la bagnole et la pollution qu’elle génère, ces temps, les nôtres, inventent les péages urbains, réduisent les chaussées au profit des trottoirs, mais omettent d’améliorer et de rendre fiables les réseaux de transports en commun. Contre la raréfaction des espaces naturels, ils végétalisent les toits, à condition qu’ils soient plats – quand en même temps on continue de fermer des squares et de minéraliser l’espace public – ou ils créent, plus fort encore, des jardins privatisés inaccessibles au public, comme celui de la Bibliothèque nationale de France à Paris. Partout, la déraison s’affirme ; partout triomphe la même volonté de créer, dans les grandes unités urbaines, « un espace public aseptisé, sous vidéosurveillance et non appropriable ». Il en va de même dans les périphéries avec la réhabilitation par destruction des friches industrielles et leur transformation en « éco-quartiers ». On verdit le malheur urbain en éradiquant toutes traces de ce que fut une ville. Du passé on fait aussi facilement table rase que des sociabilités humaines qu’il avait fondées. Abandonnées par les pouvoirs publics depuis longtemps, les villes moyennes, elles, végètent dans leur déshérence, sans trains, sans emplois, mais avec des architectes qui conçoivent en pagaille des zones commerciales toutes semblables dans leur laideur et leur prétention.
Partout, nous dit Barancy, la tendance est la même, folle à souhait : tiers-mondisation par abandon et naufrage d’un côté (Jakarta et São Paulo), création de villes nouvelles d’inspiration purement bureaucratique sur le modèle de Brasilia (Abuja au Nigéria, Naypyidaw en Birmanie, Sissi City en Égypte), de l’autre, développement de villes closes pour riches ou de quartiers fermés et protégés (gated communities) – dont les premiers sont apparus aux États-Unis à la fin des années 60 du siècle dernier – et smart cities hyperconnectées, enfin. S’il y a toujours pire dans la folie, celle du Néerlandais Rem Koolhaas, architecte et urbaniste (double tare !) qui a conçu et réalisé l’horrible projet d’Euralille, a franchi le mur du son avec son concept inhumain de « ville générique », ou « post-ville », défini, rien de moins, comme vecteur d’ « une ville dépouillée de son carcan identitaire, de son passé même (on fait semblant d’en conserver un minimum) ; une ville libérée de son centre, qui ne se définit plus que par sa périphérie, qui pousse constamment et envahit la campagne. Elle n’est plus horizontale, mais verticale. Elle est inorganique et climatisée. » Rideau. Notons, pour finir, que ce fou furieux, qui dit avoir été influencé par les situationnistes, est la coqueluche des médiacrates parisiens.

Quand on aura pendu le dernier architecte du néant avec les tripes du dernier bureaucrate du capital accumulé s’ouvrira un nouveau temps de l’histoire humaine réhumanisée. En attendant, il faut faire tâche, comme Olivier Barancy, en opposant la raison du possible à la folie destructrice du présent. Certains architectes partisans du slow built (« construit lentement ») s’y attellent déjà en privilégiant la réhabilitation du patrimoine existant, quel qu’il soit, et l’entretien effectif du déjà-bâti. C’est dans cette perspective salutaire, par exemple, que s’inscrit Patrick Bouchain, concepteur du « Lieu unique » de Nantes, de « La Belle de mai » de Marseille et de « La Condition publique » de Roubaix. Une raison de ne pas désespérer tout à fait de notre humanité commune.
Mathias DOPPEL
