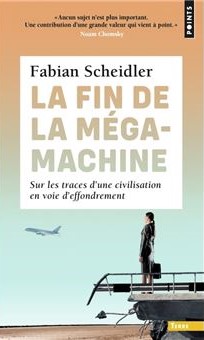
■ Fabian SCHEIDLER
LA FIN DE LA MÉGAMACHINE
Sur les traces d’une civilisation en voie d’effondrement
Première édition : Seuil, 2020, 624 p.
Seconde édition : Points-Seuil, 2023, 528 p.
Traduit de l’allemand par Aurélien Berlan
Je me souviens, tournant les pages de mes mains moites, de l’effroi, de l’impossibilité de prendre la réelle mesure de ce que je lis. Quel âge j’ai ? La vingtaine peut-être. Il est tard pour s’ouvrir à la politique mais je viens d’un milieu où très peu m’a été transmis. Ma « conscientisation » se fait alors que je suis jeune adulte. J’avale des kilomètres de lecture espérant rattraper un retard que je ne comblerai jamais. Je lis Les Veines ouvertes de l’Amérique latine d’Eduardo Galeano (1940-2015) et je ne sais plus par quel hasard ce bouquin a atterri entre mes mains. Ce que je sais par contre c’est que sa lecture me suffoque. L’ampleur des massacres et du pillage du continent sud-américain est d’une telle ampleur qu’il me sidère. « L’histoire est un prophète au regard tourné vers l’arrière : à partir de ce qui a été et en opposition à ce qui a été, il annonce ce qui arrivera », écrit Galeano. Quelques paragraphes plus loin, l’Uruguayen résume un long continuum historique : « Les conquistadores sur leurs caravelles voisinent avec les technocrates en jets, Hernán Cortés avec les Marines nord-américains, les corregidores [1] du royaume avec les missions du Fonds monétaire international, les dividendes des trafiquants d’esclaves avec les gains de la General Motors. » Galeano écrit ces lignes à la fin des années 1960. Un demi-siècle plus tard, le dramaturge et essayiste allemand Fabian Scheidler note ceci dans son introduction de La Fin de la mégamachine : « Le processus d’expansion qui a commencé en Europe il y a cinq siècles se révèle être une histoire qui, pour la plus grande part de l’humanité, fut d’emblée synonyme de déportation, de paupérisation, de violence massive – allant jusqu’au génocide – et de saccage des territoires. Cette violence n’est pas révolue. Il ne s’agit pas d’une maladie infantile du système mais de l’une de ses composantes structurelles et durables. Ce qui se profile à l’horizon, la destruction des conditions de vie de centaines de millions d’êtres humains par l’aggravation du changement climatique, nous le rappelle aujourd’hui. »
La Fin de la mégamachine est une somme dont on émerge à la fois ragaillardi et sonné. Avec un véritable sens du récit, Scheidler est allé gratter jusqu’à l’Âge de fer les racines les plus anciennes de notre actuelle condition, soit celle d’un homo œconomicus prêt à toutes les terres brûlées pour avoir le loisir de remettre indéfiniment une pièce dans le juke-box de sa propre extermination. Un constat aussi fascinant que terrifiant qui n’étonne pas mais prend un sens tout particulier pour qui se donne la peine d’aller chercher, dans les lointains plis de la psyché et de l’histoire humaine, la genèse de nos traumas collectifs. La Fin de la mégamachine compacte ainsi cinq millénaires au cours desquels s’initie et se déploie une civilisation appelée à devenir hégémonique : la stratification et perpétuelle extension d’un bloc militaro-marchand par essence impitoyablement inégalitaire. Contrairement aux idées reçues suggérant que la sédentarisation néolithique serait la cause de tous nos malheurs, Scheidler insiste sur le fait que la véritable césure préhistorique intervient au début de l’âge du cuivre et du bronze, soit aux alentours de – 3000 avant le Grand Crucifié. Jusqu’alors, autant les nomades chasseurs-cueilleurs que les récentes communautés agricoles fonctionnaient selon des schémas à peu près égalitaires. Avec la découverte et la maîtrise des métaux et la nouvelle puissance guerrière qu’ils confèrent, la donne change brutalement. Les sociétés d’alors se trouvent soudain sous la coupe d’un « complexe métallurgique », divisées « entre la minorité qui était en mesure de se procurer et de travailler le bronze, et les autres qui n’y avaient pas accès ».
Qamis traditionnel ou costard-cravate
Désir de puissance, désir d’exploitation, les affects dominateurs s’agrègent dans les rangs d’une caste évolutive capable alors de mettre la plèbe au travail et de lever l’impôt. En cas de révolte, des armées de mercenaires feront rentrer les récalcitrants dans le rang ou, plus communément, les enverront ad patres. Ainsi des premières cités-États sumériennes. Le despote inscrit sa domination et sa lignée sur le temps long : sa légitimité ne vient pas des basses fanges mais de divinités créées pour légitimer de nouveaux crédos sacrificiels. Qui veut la paix prépare la guerre et les masses seront bien gardées. « Le Temple redistributeur et la dictature militaire ont fusionné pour donner lieu au premier État autoritaire », insiste Scheidler qui manie l’art de la redondance car, de la même manière qu’un zèbre est forcément zébré, un État est forcément autoritaire. Une libre association d’humains ne créé pas un État dont la principale caractéristique est « d’exercer un pouvoir de contrainte sur ses ressortissants ». Voilà qui est anarchiquement clair, voilà qui constitue cet invariant que l’on retrouve sous les lambris de n’importe quelle Macronie disruptive.
Ce qui intéresse Scheidler est une question aussi vieille que la Lune : non pas le pourquoi de tant de haine et de domination, mais le pourquoi de tant de soumission. Page 27, l’essayiste y va franco et droit dans les yeux du lecteur : « Pourquoi la plupart des humains ont-ils accepté que se constituent des élites qui règnent sur eux et s’emparent d’une partie de leurs revenus, sous forme d’impôts, pour financer des armées et construire des palais colossaux ? Pourquoi les humains ont-ils admis que ces élites puissent réglementer leurs rapports et même disposer de leur vie ? Comment et pourquoi, pour le dire en un mot, les humains ont-ils appris à obéir ? » La question est cash, elle annonce l’ossature de la formidable leçon que s’apprête à administrer Scheidler. On dit « leçon » avec un brin de provoc mais aussi parce que tout le génie de La Fin de la mégamachine tient dans le fait que cet essai est d’une clarté et d’une pédagogie admirables. C’est-à-dire que, le lisant, on se voit le fourguer d’autorité dans les mains de quelque jeunesse perdue dans les méandres postmodernes avec ce conseil de vieux con : « Si tu veux comprendre le merdier dans lequel on est tous – et on insiste bien sur tous, histoire de manifester notre allergie profonde aux épidémies communautaires et bien lis-ça, et médite. »
Quézaco cette « mégamachine » ? demanderont bigleux et autres pinailleurs de seconde zone. N’est-on pas en droit de renifler dans cette obscure expression quelque ferment antisystème propre aux complotistes ? Scheidler s’explique : il use là d’un concept métaphorique emprunté à l’historien et penseur de la technique Lewis Mumford (1895-1990). « La “machine” ne désigne pas ici un appareil technique, mais une forme d’organisation sociale qui semble fonctionner comme une machine. » Avec cette subtilité de taille : les rouages de la mégamachine, c’est nous. Dévoreuse de vies et de terres, la mégamachine n’a cessé au fil des siècles de rationnaliser et étendre son art de la déprédation et de l’accumulation au profit de quelques-uns. Mais toutes les bonnes choses ont une fin : considérant la diminution des humains bénéficiaires du susdit système et surtout les limites géologiques sur lesquelles il vient buter, Scheidler se fait l’apôtre d’une nouvelle qui, de prime abord, ne pourrait que nous réjouir : la mégamachine approche de son point de rupture. À ceci près que, dans sa chute, elle risque d’emporter des pans colossaux de nos écosystèmes, de tout ce qui fait de la Terre une planète encore vivable. Un brusque déclin civilisationnel, donc, qui n’a rien à voir avec celui agité par quelque cocardier cacardeur qui voit dans la sphère arabo-musulmane la principale force menaçant l’équilibre ronronnant de nos démocraties libérales. Puisque le Capital a réussi le pari de sa funeste mondialisation, alors les tentacules de la mégamachine enserrent l’entièreté de la planète – et peu importe l’allure de ses lieutenants, qu’ils portent un qamis traditionnel ou un costard-cravate. Gaz de schiste amerloque, pétrole saoudien, fission atomique franco-russe : la mégamachine est une routine extractive qui tourne à plein régime et se fout des préciosités diplomatiques. Soyons certains que ses ayatollahs de la démesure feront cramer jusqu’à la dernière forêt juste pour le plaisir d’avoir la vue dégagée sur leur propre néant.
Férocité de cost-killer
Bien avant l’Union européenne et l’OTAN, l’Empire romain fut ce premier espace où « les tyrannies du marché et de la violence militaire ont atteint leur premier acmé ». Scheidler nous apprend que la République romaine consacrait « près des trois quarts de son budget aux dépenses militaires ». La majorité de l’argent nécessaire pour payer la solde des milliers de bidasses était fournie par les masses d’esclaves trimant dans les mines. C’est à cette période que naissent les premières sociétés publicaines, prototype anticipant de manière frappante les sociétés par actions. Soit une délégation de gestion des sociétés minières à des entrepreneurs privés qui, en échange d’un forfait reversé à l’Empire, exploitaient avec une férocité de cost-killer la force de travail de pauvres hères asservis. « Les sociétés publicaines sont un bon exemple de synergie entre violence physique et pouvoir économique », écrit Scheidler, avant de préciser de quelle manière elles portent les germes de nos philanthropiques multinationales : contrairement aux entrepreneurs individuels limités par leur vie d’homme, les « sociétés publicaines étaient, en principe, immortelles et insatiables. Comme les sociétés par actions modernes, leur but unique était de tirer de toute activité économique, aussi vite que possible, le maximum de bénéfices monétaires, et ce sans restriction temporelle, indépendant de la durée de vie et des besoins concrets des propriétaires de parts ». L’auteur de La Fin de la mégamachine pourrait s’arrêter là mais non, puisque son travail consiste à expliquer que notre actuelle situation désastreuse n’est en rien le fruit de quelconques dérapages ou fourvoiements économico-politiques mais bien le résultat prévisible d’une logique comptable et guerrière métastasée à l’ensemble du globe, il insiste : « Aux deux époques [l’Antiquité et la nôtre], l’expansion de la logique marchande et le déploiement du pouvoir d’État sont allés main dans la main. Opposer, comme on aime tant le faire, "le marché libre" aux "bureaucraties d’État" est de ce fait purement illusoire. Aussi bien dans l’Antiquité que dans les Temps modernes, la création des marchés est indissociablement liée à la dynamique belliqueuse des États. »
Partant d’un tel postulat, il n’est pas étonnant que la chute de l’Empire romain et l’entrée dans les « ténèbres » moyenâgeuses représentèrent un « soulagement » pour les populations. Car, même loin d’avoir été paradisiaque, cette époque, relève Scheidler, fut capable de réduire « le pouvoir de disposition de l’homme sur l’homme – et aussi de l’homme sur la nature ». Les jacqueries paysannes – dont certaines seront mues par un « idéal de communauté égalitaire » – et la terrible épidémie de peste noire du XIVe siècle viennent soudain ébranler l’équilibre des pouvoirs médiévaux. Dans un court chapitre intitulé « La naissance du monstre », Scheidler aborde dans le détail ce moment charnière où l’ancien temps doit peu à peu s’effacer pour que naisse le « système-monde moderne ». Avec pour condition expresse que les élites conservent leurs prébendes et la société son socle inégalitaire. Bref, guépardisant à outrance, on pourrait dire qu’il fallait que tout change pour que rien ne change. Citons Scheidler dans ce développement décisif : « Contrairement à ce que prétend le mythe de la modernité, ce système ne s’est pas développé à partir de l’innocente soif de connaissance et d’aventure qui aurait animée les “inventeurs” et les “pionniers” qui ont secoué l’étroitesse d’esprit du Moyen Âge. Il est né des efforts que les élites de l’époque ont faits pour étouffer les aspirations égalitaires qui montaient. Dans ce processus, elles n’ont pas choisi de processus planifié. Personne, ni les banquiers, ni l’Église, ni les seigneurs ou les princes, n’étaient capables d’imaginer le système qui, après trois siècles de luttes sociales, allait finalement se mettre en place en Europe avant de se lancer triomphalement à la conquête du monde. Ce qui s’est passé, c’est plutôt que d’innombrables démarches des différents acteurs ont fini par se nouer en un système qui a engendré les monstres de la modernité. »
Système et sous-système
La suite, malheureusement, nous est plus familière. Assumant une visée anarchiste, Scheidler récuse catégoriquement la fable hobbesienne d’un « contrat social » comme base de l’État. « Les États modernes ne sont apparus ni pour le bien des populations, ni avec leur assentiment, affirme l’essayiste, mais en tant qu’organisations fondées sur la violence physique ». Il est tout autant jubilatoire de lire ce trait acide et lucide sur les fondements de l’école moderne « née de la rencontre entre l’ascèse chrétienne et le dressage militaire ». Urbanisme, psychologie, économie, technique, religions, le tison de Scheidler fourgonne avec étourdissement un vaste champ interdisciplinaire. Ses intuitions, souvent redoutables, cristallisent un chaos social qui perd soudain son opacité. Tout fait alors sens.
Logicien imparable et inquiet pour nos futures miches, Scheidler nous livre cette évidence que n’importe quel minot du cours élémentaire doit être à même de comprendre : « Toute société humaine, y compris son économie, est un sous-système de la planète Terre. Elle vit des flux de matières dans ce système d’ordre supérieur, de sa capacité à mettre à disposition de l’eau, de l’air respirable, de la nourriture, des minéraux et des conditions météorologiques relativement stables. La Terre peut très bien se débrouiller sans sociétés ni économies humaines, mais ces sociétés et ces économies ne peuvent pas un instant exister sans le système vivant ultracomplexe qu’est la Terre. Si le système d’ordre supérieur s’effondre, le sous-système périt aussi. Pour cette simple raison, l’idée que l’économie et la technique humaines puissent dominer la nature est aberrante. Un sous-système ne peut jamais prendre le contrôle du système d’ordre supérieur dont il dépend ».
Sept ans après avoir rédigé Les Veines ouvertes de l’Amérique latine, Galeano proposait une postface inédite pour l’édition de poche de son livre. Il terminait ainsi, sur une note d’optimisme : « (…) dans l’histoire des hommes, chaque acte de destruction trouve tôt ou tard sa réponse dans un acte créatif ». Vu l’ampleur des ravages auxquels nous assistons, autant dire qu’un champ des possibles s’offre à nous pour espérer voiler, définitivement, la vieille roue de l’Histoire.
Sébastien NAVARRO
